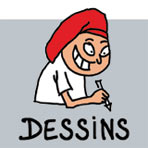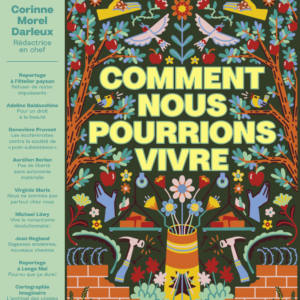Portraits d'actrices et d'acteurs associatifs (Suite)
 « En 1990, j’ai été le premier gitan à avoir le baccalauréat ! »
« En 1990, j’ai été le premier gitan à avoir le baccalauréat ! »
« J’ai d’abord été trésorier d’un club de foot avant d’en devenir le président et de fonder ensuite Cap Gély Figuerolles, du nom de la cité et du quartier où se concentrent, à Montpellier, 95 % de la communauté gitane dont je suis issu. Quand mes grands-parents sont arrivés d’Espagne, ils ont été obligés de se sédentariser. C’est une communauté qui s’exprime peu mais qui a pourtant des besoins et des manques criants. C’est la plus discriminée de tous les temps. Ça commence dès l’école, avec les enfants. En 1990, j’ai été le premier gitan à avoir le baccalauréat ! Il y avait des associations dans le quartier, mais elles venaient prendre le pognon et rien d’autre. Avec Cap Gély Figuerolles, on a une réelle expertise de terrain. Et on a recensé les besoins. Au début l’association ne proposait que du sport, puis petit à petit, on a mis en place des activités socio-culturelles. Et l’an dernier, grâce à la Fondation Abbé Pierre, on a pu créer notre premier festival gitan : Le Festival International Mosaïque Gipsy Bohème. Pour l’occasion, on a investi un lieu culturel de Montpellier, la Halle tropisme. On a vécu quatre jours de partage et de mixité. Et pour nous, mélanger les populations, c’est important ! »
Stéphane Hernandez, fondateur et trésorier de Cap Gély Figuerolles (34)
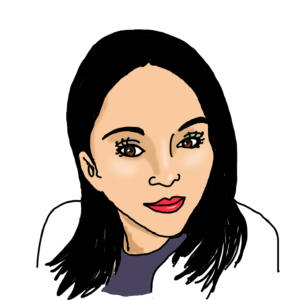 « J’ai des valeurs qui m’ont poussée à m’engager »
« J’ai des valeurs qui m’ont poussée à m’engager »
« J’ai eu une enfance et une jeunesse difficiles. Mon père a fait de la prison et il est mort, lorsque j’avais quatre ans. J’ai été élevée par une femme qui n’était pas ma mère, mais qui m’a accueillie comme si j’étais son enfant. Et surtout elle m’a donné des valeurs qui m’ont poussée à m’engager. Ça fait 20 ans que je suis dans le social. J’ai bossé en CHRS (Centre d’hébergement et de réinsertion sociale), à l’Aide sociale à l’enfance, pour la Protection judiciaire de la jeunesse… Ensuite, j’ai travaillé 11 ans comme éducatrice de rue à Montreuil et à Aubervilliers. En étant salariée, j’ai rapidement vu les limites de nos actions. Notamment au niveau de l’accompagnement des jeunes majeurs. On les suit depuis l’enfance, mais quand ils atteignent 21 ans, il n’y a plus d’aide. Alors qu’à ce moment-là, ils sont fragiles, ils risquent de basculer et ils ont besoin de nous. De ce constat d’impuissance, est née, en 2017, l’association Émergence 93. Nous sommes quatre fondateurs, trois éducateurs de rue et un bénéficiaire. Ensemble nous avons constaté que les jeunes avaient envie de travailler, et qu’ils avaient du potentiel. Et pour nous, peu importe les diplômes, tout s’apprend. D’où la création de la station de lavage auto, impulsée par l’exemple d’un jeune du quartier. Ce qui m’a sauvée dans mon parcours, c’est l’autonomie financière. Le travail apporte un rythme et un cadre. On bosse aussi sur la relation au collectif : se lever le matin, s’écouter les uns les autres… Et sur la solidarité. »
Charlotte Prando, 37 ans, éducatrice et cofondatrice d’Emergence 93, à Aubervilliers (93)
 « Je porte en moi les problèmes des familles »
« Je porte en moi les problèmes des familles »
« C’est naturel pour moi de m’investir. Si je peux rapporter les problèmes qu’il y a dans le quartier, c’est parce que je discute beaucoup avec les gens, mais surtout parce que ces problèmes, je les connais, je les ai vécus. Quand je parle des marchands de sommeil, de la prison, de la suroccupation des logements, et de l’impact que ça a sur l’école, je sais de quoi je parle, j’ai connu ça. Quand quelqu’un a faim, je sais ce que c’est. La volonté de créer une académie d’excellence, c’est parce que dans le quartier, il n’y a pas d’outil qui permette de construire son rêve. Ce qui manque aux jeunes, c’est l’estime de soi. C’est une lacune que j’ai moi-même. C’est important de travailler là-dessus. Au Petit Bard, on a mené un combat qui a duré plusieurs années pour éviter les expulsions. On a rien lâché. Quand on a été confronté soi-même à ces problématiques, on comprend mieux le gamin qui ne veut pas rester chez lui. Moi, petit, je n’avais pas vue sur mer mais vue sur ma mère (Rires). Mais toutes ces choses m’ont forgé. Aujourd’hui, je peux parler avec le préfet, il m’écoute. Parce que je ne masque pas les difficultés et que je reste fidèle à la parole des habitants. Je n’arrive pas à avoir de la distance, je porte en moi les problèmes des familles. Les gens du quartier me font confiance car ils savent d’où je parle. On ne peut pas me discréditer car mon discours est cohérent. Je me fiche des médailles, tout ce que je veux c’est outiller les habitants pour qu’ils se prennent en main, seuls. » Hamza Aarab, 39 ans, Président et Dirigeant du Montpellier Méditerranée Futsal (34)
 « Je suis arrivé dans le social par la petite porte »
« Je suis arrivé dans le social par la petite porte »
« Je suis venu du Maroc à l’âge de 22 ans. Ensuite je suis parti vivre en Belgique. Je suis biologiste de formation, au Maroc j’ai travaillé dans un laboratoire d’agro-alimentaire. Mais en France, il n’y avait pas d’équivalence. J’ai été d’abord magasinier pendant des années avant de démissionner. J’ai fait pas mal d’intérim. Et je suis arrivé dans le social par la petite porte. En 2000 je suis venu m’installer à Lille, car ma femme est originaire d’ici, on a habité le quartier du Faubourg de Béthune. A l’époque, j’ai commencé en accueillant les enfants du club de judo du Centre social et en mettant en place des ateliers d’alphabétisation. J’ai toujours eu une fibre sociale, depuis petit. Je menais beaucoup d’activités au sein du centre social, mais je n’avais pas de qualifications. J’ai fini par passer un BTS de conseiller en économie sociale et familiale. Il y avait pas mal de matières scientifiques, ça tombait bien. Je me suis retrouvé à 38 ans à l’école. Le seul homme et le plus vieux, dans une classe de femmes. J’ai enchaîné ensuite le diplôme d’État, tout en reprenant le travail. En parallèle, j’ai pris la responsabilité de 8 salariés au Centre social, avec des activités pour les jeunes, la création d’un atelier couture, notamment avec des hommes… Puis je me suis retrouvé à gérer deux antennes. C’était compliqué de préparer le diplôme en même temps. Mais je l’ai eu en 2010 et en 2012, le Lavoir est né. J’ai commencé à travailler sur la préparation du projet. Pendant deux ans, j’étais à mi-temps au Lavoir et à mi-temps au Centre social sur l’accompagnement scolaire. Un grand écart ! J’ai pris mes fonctions de directeur à plein temps en 2014. Mon parcours est atypique, j’ai fait tous les métiers, et dans mon travail aujourd’hui, notamment en insertion professionnelle, ça me permet de savoir parler aux gens. Et de ne pas avoir de jugements. »
Driss Farahy, 51 ans, directeur du Lavoir, à Lille (59)