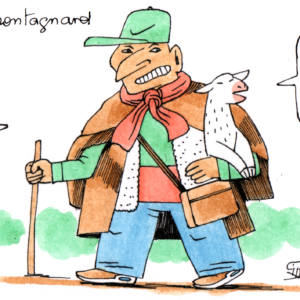Le rap, c’était mieux conscient ?

Vive le rap des années 90 ! Il était conscient, engagé. Pas comme aujourd’hui, où les rappeurs sont bling-bling. Un discours bien répandu. Mais caricatural ? Dans les années 80, la culture hip-hop commence à se populariser en France. Venu des États-Unis, le rap est surtout pratiqué dans les quartiers populaires. « Cette culture est un héritage majeur de la culture afro-américaine […] Même dans les titres les plus festifs et les plus légers, cette filiation porte l’histoire d’un peuple déraciné et exploité, en quête d’émancipation et de dignité », développe Imhotep, producteur et beatmaker d’IAM. Pour les jeunes de ces quartiers populaires, le rap était un moyen de s’exprimer sur leur quotidien et leurs difficultés, tout en s’inscrivant dans un mouvement avec des valeurs. « Le hip-hop c’était une philosophie de vie, de comportement. C’est la recherche de l’excellence dans notre discipline. Je ressortais de chaque morceau plus intelligent », résume Soly, président de l’association Sound school musical B.Vice, studio d’enregistrement historique à la Savine. Pour lui, le rap est un art engagé dans son essence même.
Les années 90 signent l’âge d’or du rap marseillais. IAM en première ligne, mais aussi la Fonky Family, les Psy 4 de la Rime, ou 3ème œil. Ces derniers ont relancé la machine en juin 2021, avec la sortie d’un nouvel EP, dix-neuf ans après leur dernier album. « Avec tout ce qui se passe en ce moment, on ne pouvait pas rester sans rien dire ou faire. On se sentait coupable alors qu’on a le moyen de s’exprimer au travers d’un mic’ », affirme Jo Popo, un des deux rappeurs du groupe. Dans leur nouvel EP, ils signent le morceau Bienvenue à Babylone avec Keny Arkana, brûlot contre les politiques au pouvoir. « On sait qu’vous êtes des vendus / Vous propagez la psychose / Vous protégez les coupables / Les vrais et les mensonges d’État s’appuient fort », balance Keny Arkana dans le refrain.
Insuffler la contestation
Si le rap engagé dénonce et s’exprime, c’est aussi pour toucher un public et le sensibiliser. « Je pense que les textes peuvent aider les jeunes à ne pas s’enfermer et à les faire grandir. Ça leur donne une touche d’espoir, les aide à se battre », explique Jo Popo. « On cherche à parler au plus grand nombre, sans appartenance de classe, ni de race », ajoute Boss One, son acolyte. Pour Soly, la culture hip-hop est un moyen d’éduquer et de transmettre une mémoire. En particulier celle d’Ibrahim Ali, jeune rappeur de B.Vice, tué en 1995 par des colleurs d’affiche du FN au retour du studio. « À B.Vice, nous essayons de rappeler cette histoire, celle de cette ville et de ce pays qui sombrent de plus en plus vers le fascisme », ajoute Soly, la voix grave. Des ateliers d’écriture et de débat sont organisés par l’association.
L’héritage des artistes hip-hop engagés des années 90 est repris par des rappeurs plus récents qui portent un rap politique. « On fait de la musique parce qu’on essaye de changer ce monde. Il y a plein de phénomènes sociaux à dénoncer : la culture du viol, le système capitaliste, le massacre animal… », énumère Temsis, du groupe À Contresens (ACS), qui arbore un tee-shirt contre la fourrure. Ce Marseillais de la Pointe Rouge fait du rap depuis 2016 avec Démos, un ami des Goudes. Ils défendent un rap « non-désengagé », qui prend position et lutte contre les oppressions. « Notre rap c’est une stratégie politique. On essaye de toucher les jeunes, artistiquement, pour se glisser entre Damso et Ninho, et donner accès à une politisation », ajoute-t-il.
« Les vieux ont crié dans le vent et ça n’a rien changé. »
Soprano en passant par Naps, ne font plus la même musique que leurs aînés. Les rythmes sont plus dansants, les titres moins centrés sur le texte. Est-il pourtant moins politique ? « La société elle-même est moins éveillée, moins consciente qu’avant, souligne Keny Arkana. Je suis pour la liberté, ne pas se donner de dogme ou de règle. Il vaut mieux être sincère et dire ce qu’on a sur le cœur plutôt que de jouer au faux militant. » « Le rap il est toujours là, il est vivant, vivace, ça bouillonne de partout mais je regarde ça aujourd’hui comme une musique de jeunes, bien que j’en fasse encore partie, analyse Soly de B.Vice. C’est devenu de la variété. Les rappeurs aujourd’hui sont dans le simple constat des choses : je vis ma vie et je veux pas me prendre la tête, parce que les vieux ont crié dans le vent et ça n’a rien changé. » Comme une forme de résignation.
« Parfois, les rappeurs percent à seulement 16 ans. Qui les a fait monter sur une image de gangster ? Qui est le patron blanc de 50 ans qui les a mis là ?, pointe Temsis d’ACS. Les rappeurs, ce sont des gens de quartiers populaires qui ont eu le choix entre ça et la misère. » Anthony, son acolyte, pointe du doigt l’opacité de l’industrie musicale et les choix faits de mettre en avant un rap marketing. Pour Imhotep, les formes de rap engagé et plus mainstream ont toujours coexisté. Mais c’est la deuxième catégorie qui est aujourd’hui largement mise sur le devant de la scène. « La censure « économique » explique aisément l’apparent « désengagement » du rap-variété mainstream d’aujourd’hui. Il occupe l’espace réservé auparavant à la pop-music et à la chansonnette », analyse-t-il. Pour parer à cela, le producteur fouille régulièrement sur internet pour découvrir de nouveaux artistes.
Même paie pour tous
Et les artistes, sont-ils désengagés ? Rien n’est moins sûr. Avec l’accès à la médiatisation et à l’argent, certains rappeurs dits « mainstream » les mettent à profit pour des causes solidaires. A Font Vert, son quartier, Soso Maness distribue des repas. Il rêve d’y créer une bibliothèque. Lors du premier confinement, Jul a levé 300 000 euros pour les hôpitaux de France, avec l’aide d’autres rappeurs. « Je trouve que c’est une génération qui a tout compris. Elle sait comment utiliser son image, et son réseau pour faire des choses. Si j’avais leur puissance de frappe, je ferai d’autres choses, parce que j’ai d’autres sensibilités », affirme Boss One. Pour lui, la cause des migrants et de leur accueil aurait sa priorité.
Sur l’album 13 organisé, où Jul a rassemblé cinquante rappeurs marseillais de toutes générations, il a donné la même rémunération à tous. Un projet 100 % marseillais, qui porte aussi en fond un pied de nez au centralisme culturel parisien. Un esprit contradictoire et chauvin, bien marseillais. « Ils réussissent à s’en sortir, et ça fait connaître Marseille, ça aide ceux qui arrivent derrière, c’est une autre façon de consommer le rap mais c’est respectable », commente Jo Popo. Et même le rap « d’avant », conscient, peut se voir critiqué par la nouvelle génération de rappeurs engagés. « Parfois, un rap qui est dit engagé parle de violences policières mais n’a pas un mot sur l’homophobie, la transphobie, le sexisme ou le massacre des animaux », nuance Temsis de ACS, qui souhaite porter ces luttes. Le rap, ça sera peut-être toujours mieux après.