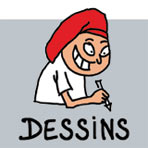Dansez, sinon nous sommes perdus

« Nassim c’est la brise de printemps, el-Raqs c’est la danse au sens de mouvement physique et symbolique, au sens d’élévation », explique Emilie Petit, artiste visuelle de formation et fondatrice du Festival Nassim el-Raqs, qui pendant huit ans, a redonné un souffle de vie aux espaces publics d’Alexandrie et à ses habitants. Le rendez-vous est pris à La Cité des Arts de la rue, dans le 15ème arrondissement de Marseille. Emilie Petit, rentrée d’Égypte depuis 2018 où elle a vécu pendant dix ans, y a installé les locaux de son association Momkin-Espaces des possibles.
Sur le mur, l’affiche de la 7ème édition de Nassim El-Raqs, en 2018, la dernière, portée par la fondatrice. Il s’agit de la photo d’une entrée de garage, baignée de soleil, au rideau levé laissant entrevoir le pare choc d’une voiture bleue et sa plaque d’immatriculation sur laquelle est notée « Egypt ». A droite, sur le bitume, une planche en bois soutenue par deux pneus et sur laquelle est dessinée une danseuse, en tenue de ville. Autour de la table, Hadir Nached Fadlel-Mawlah et Youssef Abdelmaged, ne ratent pas une miette de l’interview. Ces étudiants aux Beaux-arts sont tout droit venus d’Alexandrie en service volontaire international, à la demande de Momkin, pour mener, pendant un an, un travail de recherche et d’archivage autour de ce festival international hors norme.
Nassim el-Raqs est né de la rencontre à Alexandrie, d’Emilie Petit qui à l’époque travaillait à la grande bibliothèque et du professeur de ballet Lucien Arino, fondateur en 2008, dans la ville égyptienne du Centre de danse Rézodanse. Le festival s’est imaginé et construit sur une nécessité forte d’investir l’espace public et d’inventer de nouvelles formes de possibles pour la création et la diffusion artistique en Egypte. « Avant d’arriver en Égypte, j’ai passé deux ans sur un bateau qui naviguait entre la Sicile, la Tunisie et l’Algérie en résidence d’écriture. Le lieu était a priori inapproprié mais cela fabrique des situations qui déplacent tout le monde hors des clous de l’art contemporain », explique la plasticienne. En vivant deux ans en milieu très resserré, sur un bateau et sur des îles, elle a ressenti un besoin impérieux de mouvement et d’espace.
Investir l’espace public
Débarquée à Alexandrie, elle découvre une ville où les couches de mémoire et d’histoire centenaires et millénaires se superposent. « Comme un millefeuille. On sent cette présence inscrite dans les murs », note-t-elle. Nait alors l’envie de « raccrocher toutes ces couches », et de trouver des artistes pour faire vivre cette matière. Elle se rapproche de danseurs contemporains. « Alexandrie fait partie des ces villes comme Marseille ou Alger, dont on ne tombe pas amoureux tout de suite. Elle a quelque chose de rugueux, où fabriquer sa légitimité n’est pas facile », souligne-t-elle. Mais elle envisage « la Méditerranée comme une matière à écrire et qui fasse sens et communauté ».
Lucien Arino apporte pour elle une réponse artistique pertinente en Méditerranée. Ensemble, ils réfléchissent, elle lui raconte son expérience artistique sur le bateau, son travail de recherche sur Alexandrie et ils cheminent ensemble vers cette envie folle d’investir artistiquement l’espace public. L’époque n’est pas facile, on sent les soubresauts de la révolution qui se prépare. Mais ils finissent par rallier à leur cause pas mal de partenaires institutionnels. Et deux égyptiens les rejoignent dans leur projet d’aventure, Hatem Hassan et Reem Kassem. Emilie s’attache à ce que leurs noms soient dits : « Car on ne retient souvent que les noms des français. Mais Nassim el-Raqs a été un travail d’équipe. Et sans eux, on n’aurait pu rien faire. »
Reem Kassem a la charge la plus complexe, celle de négocier avec la police et l’armée pour que l’espace public, chaque printemps, puisse être investi par des cohortes de danseurs et de performances artistiques. En 2011, la première édition est lancée. Le festival n’aura de cesse de rayonner pendant toutes ces années. Il devient incontournable, les danseurs les plus prestigieux s’y produisent et transmettent aussi aux artistes égyptiens, c’est la condition. Et ces derniers investissent des espaces publics improbables. De 2016 à 2018, dans le cadre du projet européen Shapers, d’autres artistes venus de Marseille comme la compagnie Ex-Nihilo (lire encadré), de Casablanca, de Sarajevo et de Séville, se joignent aux équipes égyptiennes. En 2017, ils performent sur l’esplanade de la mosquée Abu al-Abbas al Mursi qui accueille la tombe du saint alexandrin soufi du même nom. Du jamais vu. Avec l’assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo, Emilie Petit voulait qu’un signal fort, une autre image, multiculturelle, symbolique soit envoyée à l’Europe.
« Face à l’impossible, il faut proliférer »
Cette même édition a accueilli le chorégraphe Olivier Dubois qui a investi avec ses danseurs une trentaine de lieux en simultanée, là aussi une première dans un espace public contraint, où il est interdit de se rassembler à plus de dix. Ce dernier a, pour l’occasion, transmis les pas de L’Après-midi d’un faune, de Vaslav Nijinski, à une vingtaine de danseurs égyptiens, considérant que ce ballet « appartient au patrimoine de l’humanité ». Emilie Petit apprécie : « C’est une chorégraphie qui doit respecter des règles de transmission et que peu de danseurs connaissent. Ce geste d’Olivier Dubois est un basculement dans l’histoire de la danse. » Et le chorégraphe d’affirmer à la fondatrice que « face à l’impossible, il faut proliférer ». Pendant sept ans, Nassim el-Raqs a permis les plus grandes folies dans un pays qui gronde et qui gronde fort.
Le début du festival a connu la Révolution, les tensions qui montent, les Égyptiens qui meurent et ceux qui fuient pour sauver leur vie. « On sentait la révolution vibrer de partout. En tant que Française, je ne suis pas descendue dans la rue, car je considérais que ce n’était pas mon histoire mais surtout pour ne pas mettre mes amis en danger d’être vus avec une étrangère. On a cru à la révolution et au changement », explique Emilie Petit qui pourtant, années après années, et la prise de pouvoir de Sissi, voit ses amis être arrêtés, d’autres tués. « Quand la peur s’immisce au sein de l’équipe, c’est terrible. La plupart ont dû quitter le pays. Je suis restée seule aux commandes », souligne-t-elle.
A partir de 2014, c’est elle qui doit discuter seule avec l’armée et la police pour que le festival puisse avoir lieu. «C’était horrible car je devais négocier avec ceux qui tuaient mes amis, s’émeut-elle. Mais je ne pouvais pas partir, rester était devenu un acte politique et citoyen en pleine dictature. On était en permanence sur cette ligne fragile face à la violence des armes. Et à se poser la question de “qu’est ce que l’art peut changer à la politique” ? » Mais par peur de mettre en danger son équipe, les artistes et les publics, elle finit par renoncer. La 7ème édition sera la dernière pour elle. En 2018, elle passe le Flambeau à un chorégraphe qui finira par quitter le pays lui aussi. « Je suis restée jusqu’au bout, mais j’étais de plus en plus épuisée. J’ai vécu le retour comme une abdication. J’étais un zombie », se désole la fondatrice.
C’est cette histoire que vont devoir raconter et archiver les jeunes volontaires égyptiens. Pour Emilie Petit, il était important que ce récit soit aussi porté par celles et ceux qui l’ont vécu, en tant que spectateurs. Ils avaient 19 et 20 ans à l’époque mais Nassim el-Raqs, leur a donné l’espoir d’un possible. « Ça nous a ouvert d’autres perspectives » , conclut Hadir.
Le titre de cet article est une citation de la danseuse et chorégraphe Pina Bausch.