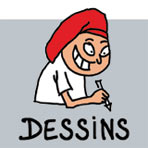Nouvelle « her » pour le militantisme lesbien

Papillon de lumière, pourquoi ce serait toujours les mêmes sous les projecteurs ? Dimanche 13 juin, entre 60 et 70 personnes bisexuelles ou lesbiennes, activistes ou simples concernées, se réunissent au Parc Longchamp à Marseille pour former un collectif en non-mixité. Sous le nom encore provisoire d’Assises Lesbiennes, elles font le choix de militer pour leurs droits hors d’un milieu LGBTQ+ (1) généralement dominé par les imaginaires gays. Une grande première pour le mouvement lesbien local. Noémie Pillas, co-présidente de l’association Fierté Marseille Organisation, chargée de la coordination des événements de la Pride Week (1) qui a débuté le 24 juin, salue « la rencontre des Assises Lesbiennes, l’événement qui manquait à ce milieu Marseillais ».
Jeu d’équilibriste
Loin de faire une mauvaise concurrence à la semaine événementielle qui se terminera en beauté par une marche des fiertés le samedi 3 juillet, les Assises Lesbiennes complètent plutôt, aux yeux de Noémie Pillas, les lacunes de la Pride Week : « la Pride est un support pour l’ensemble des associations LGBTQ+, elle n’assure pas de dispositifs spécifiques pour une partie de la communauté. C’est vrai que la communauté gay a toujours été dans la lumière, mais je ne me vois pas être dans une démarche de « visibiliser » plus les lesbiennes que les personnes trans ou intersexes (1), l’équilibre est difficile à trouver. »
Moins présentes dans les représentations culturelles et moins influentes que les hommes cis-genre (1) dans les cercles militants dédiés à la lutte contre l’homophobie, les personnes lesbiennes ou bisexuelles se retrouvent régulièrement en minorité…au sein de leur minorité. Noémie Pillas le confirme : « C’est toujours le serpent qui se mord la queue. A la Pride dans l’équipe notre rôle c’est de chercher des personnes qui ont des compétences, du réseau et comme d’habitude les personnes qui possèdent tout ça sont majoritairement des hommes. » Ce plafond de verre est le produit dérivé du sexisme qui se combine parfois à de la transphobie et/ou à d’autres discriminations (racisme, validisme (1), antisémitisme…). Mais il peut aussi s’expliquer par la structuration historique difficile de l’activisme lesbien d’abord rattaché aux mouvements féministes avant l’apparition de revendications LGBTQ+ plus spécifiques. Un lesbianisme donc précurseur mais en retard de développement, joli paradoxe.
La recherche du génie lesbien
Christian de Leusse, gérant des archives LGBT Mémoires des Sexualités et militant gay de longue date, se souvient à l’époque de la première Pride à Marseille en 1994 que « le mot lesbienne écorchait la bouche de tout le monde, traiter une femme de lesbienne c’était du mépris, alors que chez les mecs on s’est très vite réapproprié le terme pédé ». Comment alors se rassembler pour lutter quand on a encore honte de nommer son orientation sexuelle ? Autre raison selon lui : les lesbiennes et bisexuelles déjà empêtrées dans les conflits intracommunautaires du féminisme ont mis des années à militer pleinement pour des revendications concernant cette part de leurs identités.
En comparaison, la militance gay s’est construite par des luttes ciblées avec de fortes retombées médiatiques telles que la reconnaissance de la déportation homosexuelle durant la Seconde guerre mondiale, ou la prise en charge médicale du VIH. Des luttes où les femmes étaient encore une fois très minoritaires. Vient encore s’ajouter à cette liste (non-exhaustive mais déjà bien trop longue) la difficulté de se construire une mémoire. Car si les femmes sont presque totalement éjectées de l’Histoire, les lesbiennes, elles, en sont absentes. Christian de Leusse cite un exemple : « Louise Michel tout indique qu’elle était lesbienne mais en même temps rien ne l’indique, et c’est presque pareil pour tout ! » La recherche du génie lesbien dans notre histoire s’avère plus que complexe…
Changement de génération
Les récentes mobilisations en faveur de « la PMA pour toustes » et l’organisation de la deuxième marche nationale des visibilités lesbiennes le 25 avril 2021, insuffle une nouvelle dynamique. A Marseille, pendant que des militantes plus âgées sont en prise avec des organisations queer concernant des accusations de transphobie, les plus jeunes s’organisent. Laura, lycéenne, a rejoint Collages Lesbiens pour leurs premières actions marseillaises début 2021. Grâce à leur communication sur les réseaux, elle a pu rapidement rejoindre l’organisation. Coller des slogans dans les rues lui paraît important pour la cause. « On est une minorité qui ne parle pas trop. S’approprier l’espace public permet de montrer qu’on est là, qu’on existe », assure-t-elle. Ancienne campagnarde elle confie : « des personnes lesbiennes, je n’en ai jamais rencontré avant ma majorité. »
Les premières Assises Lesbiennes lui ont donc permis d’encore élargir son, tout récent, cercle de connaissances et de se rassurer en se rendant compte qu’elle n’est véritablement « pas seule ». Les modes d’actions de ce nouveau collectif ne sont pas encore définis. Peut-être interviendra-t-il dans des écoles ou aura-t-il une permanence dans un local donné par la mairie ? Tout reste encore à faire… Mais sa ligne idéologique est déjà là : c’est une organisation politique qui prône l’intersectionnalité (1) des luttes.
Deux événements en lien avec les identités lesbiennes sont organisés dans le cadre de la Pride Week :
– une conférence « virtuelles » (Facebook) de l’Autre Cercle sur la thématique « l’invisibilité des lesbiennes dans les gouvernances d’entreprises et d’associations » le mercredi 30 juin à 18h00.
– l’exposition PoM Urb dans le bar les 3g, 3 rue Saint Pierre (13005), le vendredi 2 juillet à 19h00.
Le lendemain, samedi 3 juillet, un cortège en non-mixité lesbien pour la Pride (départ 15h00, palais Longchamp en direction du Vieux Port) sera organisé par Les Assises Lesbiennes.