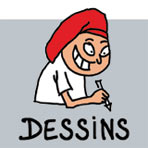Dans les années 30, "l'épidémie marseillaise"

Laurence Montel, De « Marseille Chicago » à « Marseille propre » (chap. 3)
Pp.125-126
« Marseille confirme d’abord sa position de territoire de désordre à l’échelle de la nation. C’est « La pagaille marseillaise », dans L’Ère nouvelle. La catastrophe réactive d’autre part la chronique peu reluisante de la seconde moitié des années 1930. Le 30 octobre, dans Le Journal, Clément Vautel écrit ainsi : « Depuis l’assassinat du roi Alexandre – quel désordre, avant et après cette tragédie ! – la belle cité, si favorisée à tous les points de vue, a bien souvent fait parler d’elle, mais Marius et son Olive n’y sont pour rien : exploits de bandits – le dernier est l’attaque du « train de l’or » – grèves désastreuses de dockers, réformes frauduleuses en quantités industrielles, scandales policiers sans pareils, etc. Le terrible incendie de la Canebière continue la série ». Mais Marseille est d’autre part décrite comme une personne souffrante ou déviante, selon qu’on la juge frappée par un mal exogène ou qui lui serait consubstantiel. Dans La Journée industrielle, un article de Jean Pupier en partie reproduit dans L’Ère nouvelle déclare ainsi « Marseille » atteinte d’une maladie : « […] dont le symptôme essentiel est le laisser-aller qui glisse sans presque s’en apercevoir de la camaraderie à la complaisance coupable, du débrouillage à la malhonnêteté, de l’égoïsme trop volontiers accepté à l’abandon de tout devoir national et social ». D’autre part, L’Ère nouvelle reproduit aussi un extrait de l’article d’Alain Laubreaux, auquel elle donne pour titre : « Psychologie de Marseille ». La métaphore organiciste chère aux réformateurs urbains est ici revisitée sous un angle psychique car, si l’on peut diagnostiquer une maladie marseillaise, ce n’est pas au niveau physique (Topalov, 1990 ; Payre, 2005). Si le mal était charnel, il reviendrait aux réformateurs urbains, aux aménageurs, de proposer une thérapeutique. Mais il s’agit ici de mettre un terme à des errements moraux, d’attribuer à Marseille une nouvelle direction de conscience faute qu’elle puisse se ressaisir d’elle-même, et l’on en appelle à la puissance étatique parce que ce mal, contagieux, menace un autre organisme, celui de la nation. Pour Jean Pupier, « le pays tout entier souffre de ce qu’on pourrait appeler « l’épidémie marseillaise » ». Cette épidémie serait « à coup sûr mortelle si le pays tolérait plus longtemps son extension ». Marseille, ses élus socialistes et leurs administrés sont amalgamés. Ils partagent les mêmes travers : manque de rigueur, d’intégrité et de courage, indolence (« laisser-aller »), mépris envers l’intérêt général et la nation »…
Cesare Mattina, Dénoncer la politique marseillaise, dénoncer Marseille (chap. 7)
P.223
Les facteurs explicatifs de l’accélération des affaires de la deuxième moitié des années 2000 à Marseille sont multiples et se jouent sur des scènes différentes. Ils nous paraissent liés à trois phénomènes : les changements institutionnels de la magistrature offrant aux juges un contexte fait de nouvelles opportunités d’action ; l’émergence de nouveaux acteurs judiciaires sur la scène marseillaise s’attaquant aux phénomènes de corruption dans la continuité de leur parcours professionnel ; et les capacités inédites de nouveaux acteurs médiatiques (d’une presse d’investigation venant de médias associatifs et alternatifs détachée des partis politiques) qui parviennent à révéler des affaires politico-financières
Pp.232-233
« Plusieurs travaux ont déjà montré que la rhétorique mythologique provenant d’imaginaires produits par le cinéma et la littérature autour du « mitan » ou du « milieu » marseillais a été fortement présente dans la presse locale et nationale depuis les années 1920 pour dénoncer les bandes criminelles organisant la prostitution, la contrebande et les trafics de drogue liés à la french connection (Montel, 2014), en même temps que pour souligner des liens supposés consubstantiels entre ces milieux du crime et certains leaders politiques marseillais (Samson, 2017). La construction de ces mythologies déformantes se renouvelle dans la rhétorique médiatico-judiciaire de cette récente phase d’intensification des enquêtes judiciaires à Marseille. Depuis une dizaine d’années, le substantif « mafia » et l’adjectif « mafieux » sont fortement utilisés. Cela est évident dans le langage d’essai journalistique, mais aussi dans une certaine rhétorique judiciaire, parfois coconstruite avec les médias, que l’on retrouve notamment dans l’affaire Guérini. Plusieurs essais ces dernières années n’hésitent plus à utiliser ce terme en l’associant à « Marseille » dans leurs titres et/ou dans leurs textes. Ancien journaliste au Méridional, José D’Arrigo utilise ces deux registres de la dénonciation de Marseille dans son livre Marseille mafias (2012). Après le titre de la première partie « Mafia politique », D’Arrigo introduit ses chapitres par les titres suivants : « Un clientélisme de racolage » (chap. 1) et « L’esprit de clan » (chap. 4). La deuxième partie intitulée « La mafia culturelle et sociale » contient le chapitre « La mafia des squatteurs de subventions » (chap. 2) et « La mafia économique » (chap. 3). Pour compléter ce cadre, la troisième partie de l’ouvrage s’intitule « La mafia règne sur les quais » et la quatrième « La mafia judiciaire ». Tous ces titres et ce langage annoncent ainsi l’amalgame permanent entre mafia et pléthore de phénomènes différents : les relations clientélaires, la corruption, la mauvaise gestion des collectivités locales, les grèves. Là où le terme « mafia » n’est pas explicitement utilisé, ce sont les « parrains » qui apparaissent, la french connection ou les trafics de drogues préfigurant des organisations criminelles de style mafieux. La « mafia » devient ainsi un terme de dénonciation de tous les « maux » de la ville. Chez D’Arrigo, un des maux de cette ville est la présence d’une trop grande population d’origine immigrée. Utilisant à plusieurs reprises « les Marseillais natifs », D’Arrigo réitère les passages dédiés à la présence « trop massive » des Maghrébins à Marseille en se cachant derrière les témoignages volontiers xénophobes, arabophobes et islamophobes de journalistes, d’élus, d’écrivains. Ainsi, selon un ancien adjoint au maire de Gaudin : « La Canebière [qui] était une artère typique, elle est devenue casbahitique et […] si l’on fait le compte de ses kebabs et de ses snacks halal on comprend mieux le nouvel emblème de Marseille » (D’Arrigo, 2012, p. 309). »
« Il cite ensuite un ancien chef de service au Méridional et directeur de la communication au Conseil régional estimant que : « Le problème majeur de Marseille […] c’est son islamisation rapide et spectaculaire […]. Marseille c’est un mélange d’Alger et Abidjan, elle compte près de 400 000 Maghrébins et Africains sur 900 000 habitants. Qu’en sera-t-il dans vingt ans ? Marseille va devenir une ville musulmane et polygame » (D’Arrigo, 2012, p. 323). »
« Avec cette rhétorique évoquant les théories conspirationnistes du « grand remplacement » typique des milieux de l’extrême droite, D’Arrigo semble renouer avec une partie de la tradition des vieux pamphlétaires du XIXe siècle dénonçant, à l’époque, la corruption d’un point de vue moraliste et de « retour à l’ordre » souvent de façon antidémocratique et antiparlementaire (Passard, 2018) »…
P. 236
« Que ce soit par le biais de l’accusation mafieuse, de corruption ou de clientélisme, certains registres rhétoriques repérés à la fois dans le langage des médias et des acteurs judiciaires s’apparentent à du culturalisme essentialiste et naturalisé renvoyant à un traitement de « Marseille » au-delà de la dénonciation de ses acteurs. Les dénonciations de ces phénomènes sont ainsi de plus en plus liées à l’appartenance « ethnico-territoriale » de leurs protagonistes et à leurs supposés caractères culturels et comportementaux tels que les intérêts familiaux et particularistes contrastant avec l’intérêt général républicain. C’est ainsi que Marseille (au même titre que ses élus ou sa population) est définie mafieuse car son banditisme est « corso-marseillais », cela résumant une « mafiosité » naturalisée. C’est encore une fois l’affaire Guérini qui donne l’occasion de cette progression dénonciatrice en particulier sous l’angle de la stigmatisation du caractère corse des échanges verbaux entre les deux frères Guérini. Une partie de la presse, tant locale que nationale, se saisit de cette rhétorique anti-corse de dénonciation des pratiques politiques marseillaises et de Marseille. Un des protagonistes de cette phase est le journaliste indépendant Jean-Michel Verne écrivant pour plusieurs journaux nationaux et locaux essentiellement sur les affaires et le banditisme dans la France méridionale ou sur l’Olympique de Marseille. Verne publie en 2014 l’essai Main basse sur Marseille… et la Corse, qui repose sur le dossier judiciaire de l’affaire Guérini. Sa rhétorique rapproche souvent les révélations venant de l’affaire Guérini aux contextes « mafieux » de la Corse, de la Sicile ou de Naples. Jean-Michel Verne raconte dans son essai que l’affaire Guérini démarre en 2009 par une lettre anonyme adressée au juge d’instruction Duchaine dénonçant les malversations des frères Guérini sur les marchés des déchets et sur la construction de l’incinérateur. Ce témoignage anonyme relèverait : « [d’]un véritable Gomorra marseillais. À Naples, c’est la Camorra qui tient le marché des déchets. À Marseille, ce serait donc les Guérini. Débute une longue marche dans les odeurs nauséabondes des détritus » (Verne, 2014, p. 57). S’appuyant sur une filature d’Alexandre Guérini par des gendarmes lors d’une de ses rencontres avec un adjoint de la mairie de Berre pour l’obtention d’un marché de déchets, Jean-Michel Verne commente : « Conversations codées, rencontres loin des regards. C’est un vrai rite secret qui est partiellement décrypté ; et toujours cette référence sicilienne qui vient à l’esprit. Alexandre, c’est Don Guérini qui ne convoque pas dans sa belle demeure du centre de Palerme. Ici, c’est sur un parking discret de Marignane qu’il se déplace » (Verne, 2014, p. 77). »