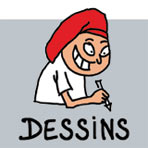"Marseille est stigmatisée depuis le 19e siècle"
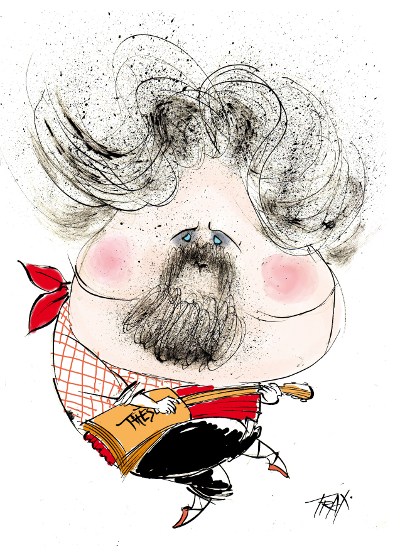
Qu’est-ce qu’une « ville maudite », et en quoi Marseille en est une ?
Les villes maudites sont des villes soumises sur une période assez longue (100 à 200 ans) – bien que ce ne soit pas forcément continu – à des processus de stigmatisations, de dénonciations, issus de rhétoriques spécifiques. Des acteurs sont présents pour alimenter cette logique : journalistes, élus (au sein de la bataille politique), magistrats, fonctionnaires, essayistes ou intellectuels. Les « grands voyageurs » américains sont un exemple de ces intellectuels qui ont participé à forger les bonnes et mauvaises réputations des villes : en se déplaçant en Europe, ils déterminaient les villes qui avaient trouvé les « bonnes façons de faire et de gouverner », et celles qui n’y parvenaient pas.
Marseille est une ville qui de façon quasi ininterrompue, est dénoncée et stigmatisée. En comparaison aux autres villes, ce processus est à l’œuvre depuis le XIXe siècle, et ne s’est jamais arrêté. C’est ce qui fait sa spécificité.
Quelles sont les spécificités de Marseille en tant que ville maudite ?
Marseille est une ville qui connaît bien avant les autres des parcours de crise économique du secteur privé. L’économie privée s’y effondre dans les années 1930 à 1950, alors qu’elle est en expansion dans d’autres villes. Le secteur public est donc le seul à s’y développer, ce qui fait que les gens sont obligés de s’adresser aux élus pour avoir des emplois, ou des logements…
Mais la spécificité de Marseille tient aussi de sa relation particulière avec Paris. Il s’est développé un rapport très complexe de fascination et d’exotisme, mais aussi de stigmatisation et de complaisance, avec cette ville aux « mœurs incertains », différents de ceux de la capitale… Un discours ambivalent a émergé très tôt sur Marseille : d’un côté on retrouvait celui des dénonciations et des stigmatisations de la ville, et de l’autre, (surtout depuis vingt à vingt-cinq ans), un discours de revalorisation d’une ville où il fait bon vivre, où l’on est proche de la nature.
Cette ambivalence est toujours présente, et on la retrouve dans le dernier discours de Macron. D’un côté, il condamne les luttes institutionnelles en les qualifiant de « chicayas » ; de l’autre, il dresse le portrait d’une ville extraordinaire, pleine d’entrepreneurs et de diversité. La stigmatisation de Marseille reste implicite et refait surface lorsqu’il la qualifie de « laboratoire de la France ». Lorsqu’il parle de Marseille, il pense alors aux banlieues, à la Seine-Saint-Denis, etc… Il y a aussi une sorte de paternalisme, notamment lorsqu’il annonce qu’il viendra contrôler la mise en place des engagements de l’État. Ce droit de regard est une forme de stigmatisation implicite !
Certains acteurs sociaux, comme les médias, dénoncent fréquemment des faits de corruption, de clientélisme, etc…, et sont parfois accusés de faire du « Marseille-bashing ». Pensez-vous que ces acteurs se complaisent à maintenir une mauvaise réputation de la ville de Marseille ?
Il y a aucun doute que de parler des trafics de drogue ou de corruption des élus, ça rapporte. Je le comprends, c’est une logique journalistique, c’est un fonds de commerce. Mais il faut prêter attention à la manière dont ces faits sont décriés : certains luttent pour dénoncer les actes de corruption ou de clientélisme, et d’autres cherchent uniquement à dénoncer la ville. Il y a des journaux et des journalistes qui vont très loin ! Dans le cas de José d’Arrigo, – un journaliste d’extrême droite que j’aborde dans le livre – l’utilisation impropre du terme « mafia » pour qualifier Marseille est systématique ! Mais il y a aussi des journalistes de gauche, qui sont coupables d’essentialiser Marseille… Le plus important, c’est de faire attention à ne pas uniquement chercher à « dénoncer », car des phénomènes beaucoup plus complexes sont en jeu.
Vous donniez à l’instant l’exemple de José d’Arrigo, est-ce que les rhétoriques d’extrême droite s’appuient sur la mauvaise réputation de Marseille pour s’exprimer plus librement ?
Oui, notamment avec des affiches très criardes sur une classe politique corrompue. Mais elle ne pousse pas très loin cette logique de dénonciation, et notamment celle du clientélisme, tout simplement parce qu’elle en est aussi un acteur.
Dans les années 90, le Front National était présent à Toulon et dans quelques autres villes. A cette époque, il était tellement mal vu et délégitimé qu’il était obligé de recruter dans le cercle amical ! Les relations clientélaires dans l’entourage de ces élus étaient donc très fréquentes. On l’a également vu plus récemment dans le 7ème secteur (13eme et 14eme arrondissements), que le RN a dirigé de 2014 à 2020 (1). La dénonciation constitue donc un levier assez limité pour l’extrême droite…
Vous écrivez que « Marseille a connu depuis 2010 une recomposition profonde du champ politique local ». Est-ce qu’on peut entendre par là que nous pouvons avoir davantage confiance en nos élus locaux ?
Je ne sais pas, il faut rarement avoir confiance. Il faut toujours contrôler les élus, et ce qu’ils font. Cette recomposition politique est due à l’effondrement d’un certain nombre de schémas, notamment des partis politiques assez puissants, qui avaient beaucoup de liens avec des associations collatérales (associations de quartier, associations ethniques et religieuses, ou syndicats d’enseignant), dans les années 1990-2000. Des attaques très fortes des différentes dénonciations, et en particulier de la magistrature à partir des années 1980 révèlent plusieurs scandales – comme les affaires Bernardini, Andrieux et Guérini (2) -, entraînant un discrédit important de toute la classe politique. Il faut quand même se méfier, ce n’est pas parce qu’il y a une recomposition totale du champ politique qu’il n’y a plus de risques.
Quel est le rapport que l’on peut établir entre Marseille et d’autres villes maudites comme Glasgow, Chicago… ?
Le but de ce livre était au départ de ne pas faire une monographie de Marseille, mais de mettre en face à face plusieurs villes, à différents moments historiques. Nous avons vu que Marseille n’était pas la seule ville dénoncée, mais qu’elle avait quand même ses spécificités, notamment celle d’une dénonciation en continu depuis le XIXe siècle. A l’inverse, la réputation de Glasgow a varié dans le temps : elle est considérée comme vertueuse pour sa gestion au XIXe et au début du XXe siècle, mais sa réputation bascule dans les années 1920-1930, sur fond de conflits communautaires entre protestants et catholiques, de corruptions d’élus et de stigmatisations des classes populaires.
Ce regard accusateur sur les plus précaires sont souvent l’œuvre d’acteurs politiques et économiques proches du pouvoir économique en place, au moment où les classes populaires obtiennent pour la première fois le suffrage universel. Paradoxalement, le grand développement du clientélisme se produit en même temps que l’expansion de la démocratie, car les gens votent avec leurs tripes ! Pour les classes populaires, il ne s’agit pas d’un vote d’opinion, il s’agit de voter pour ceux qui leur rendent service.
Est-ce que Marseille mérite sa réputation ?
Ce n’est pas le sujet du livre. Notre travail est centré autour des actes de dénonciation et des processus qui l’entourent, et n’a pas pour objectif de démêler le vrai du faux. Mais je dirais qu’il ne faut pas être trop relativiste : il y a à Marseille des phénomènes de corruption et de clientélisme réels qu’on ne peut pas minorer au prétexte que c’est une ville stigmatisée. Pour autant, il est important de ne pas affirmer que [Marseille est une sorte de terreau favorable au développement d’actes déviants], car ce serait de l’essentialisation. Essentialiser, c’est attribuer à un contexte, une capacité à générer une culture de tel type. Certes, Il peut y avoir des continuités, mais il ne faut pas affirmer qu’une culture entraîne des phénomènes.
Propos recueillis par Zoé Moreau
1. Maire de 2014 à 2017, le sénateur Stéphane Ravier y a fait embaucher son fils.
2. Respectivement maire d’Istres depuis 2008, députée des quartiers Nord de 1997 à 2016 et vice-présidente de la Région, sénateur depuis 1998 et président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône de 2002 à 2015, ils sont tous les trois socialistes et ont été condamnés par la justice pour leur utilisation toute personnelle de l’argent et des moyens publics. Si les deux premiers ont été condamnés définitivement, Jean- Noël a lui fait appel.