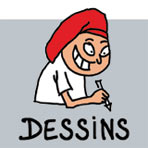Samia Chabani, sociologue « Mieux prendre en compte la participation des citoyens »

Un an après avoir intégré le Conseil présidentiel des villes, initié par Emmanuel Macron, Samia Chabani, sociologue engagée sur les questions de genre et d’immigration, directrice de l’association Ancrages à Marseille, tire un premier bilan détaillé : de grands enjeux, des moyens limités et l’attente d’arbitrages du président…
Il y a un an, j’ai accepté de participer aux travaux du Conseil présidentiel des villes. La sollicitation du président visait à mobiliser des acteurs locaux à une réflexion nationale sur la politique de la ville. Elle semblait rechercher une nouvelle méthode, articulant concertation et fonction de veille et d’alerte. A l’automne 2018, les associations ont perdu des aides conséquentes comme les contrats aidés, j’ai souhaité m’engager pour rendre compte de la situation marseillaise notamment celle des associations travaillant en proximité avec les habitants. Quel était le modèle économique attendu et pour quel impact ?
A l’occasion de la première rencontre avec le Président de la République, j’apprends que le rapport Borloo est « enterré », alors même qu’il avait donné lieu à la remobilisation des acteurs locaux (élus, bailleurs, associations). L’annonce de la création du CPV en serait nécessairement altérée. Si le changement de méthode est un argument tout à fait recevable, la suppression unilatérale du rapport m’a stupéfaite, sans me démobiliser…
Nous avons poursuivi ce travail, en rencontrant des ministres ou personnalités du gouvernement. Ce fut le cas, avec Messieurs Julien Denormandie, ministre en charge de la ville et du logement, et Jean-Marie Marx, Haut-Commissaire aux compétences et à l’inclusion par l’emploi, pour le plan d’investissement dans les compétences qui vise à former un million de jeunes peu qualifiés et de demandeurs d’emploi de longue durée faiblement qualifiés. Pour ces deux exemples, le logement comme la formation professionnelle, on peut constater, dans les faits, que la collaboration entre Etat et collectivités territoriales est complexe et participe de l’inertie sur le terrain.
Sur la question du logement Monsieur Denormandie s’est mobilisé pour trouver une solution, à Marseille, afin d’améliorer la prise en charge des délogés. Il a pu constater les difficultés des services de l’Etat à travailler avec les services de la ville ou de la Métropole et à inclure les collectifs de délogés. Comme l’a toujours rappelé la Coordination Pas Sans Nous, membre du CPV, la politique de la ville doit se faire avec les habitants.
Pour revenir au CPV, avec 6 groupes de travail (1) pour 25 membres, la charge de travail a été considérable et les moyens limités. La majorité des membres ont des responsabilités professionnelles considérables, proviseur, directeurs d’associations ou président d’Université, les profils sont divers mais donnent à voir une immersion objective dans les territoires prioritaires et une expertise manifeste. La plupart d’entre eux restent dans l’attente de l’arbitrage du Président sur les propositions produites…
J’ai personnellement souhaité animer un groupe de travail dédié à la Culture. Cet axe de travail me semble prioritaire pour en valoriser l’accès aux enfants et jeunes, en s’appuyant sur la mobilisation du champ de la médiation culturelle. L’articulation avec les Cités éducatives qui visent à intensifier les prises en charges éducatives des enfants et des jeunes sur le temps péri-extrascolaire est possible.
En un an, Le CPV a dû trouver son identité vis à vis du CNV, Conseil national des villes, dont certains membres siègent dans les deux conseils. Une rencontre avec les vice-présidents, Monsieur Braouzec, et Madame Keller, a permis de préciser le rôle de chaque conseil. Le CNV a produit de nombreux rapports qui croisent les thématiques de travail du CPV, il était naturel d’en tenir compte (2). Le CPV a cherché sa légitimité dans un contexte social tendu. Du drame de la rue d’Aubagne aux manifestations des gilets jaunes ou aux grèves des lycéens, ces événements ont donné lieu à des tensions sociales et des violences inédites dans notre pays. La question d’une meilleure prise en compte de la participation des citoyens y trouve des prolongements manifestes. De la même façon, une déclinaison genrée des politiques publiques n’est pas encore à la hauteur des besoins. Pourtant la situation des femmes en quartier prioritaire nous semble relever d’une urgence absolue.
Les quartiers populaires ont été l’écrin de nombreuses luttes sociales (3). Aujourd’hui, jardins familiaux, régies de quartiers, médiation culturelle, réseaux d’échanges de service se développent et comptent parmi les pistes essaim-ables. La vocation du CPV ne réside pas dans la production de nouveaux rapports mais dans le partage d’une nouvelle vision de la politique de la ville qui se voudrait plus transversale du point de vue de l’innovation sociale. A Marseille, depuis notre débat sur l’urgence des associations, animée par Marsactu sur l’état d’urgence des associations au théâtre de l’Œuvre, la réflexion locale se poursuit.
Le collectif Coconstruire (4) propose de travailler avec les équipes opérationnelles du contrat de ville, pour simplifier les démarches administratives des associations et libérer davantage de temps pour coproduire avec les habitants… Des pistes sont à l’étude avec les services de la Métropole, de l’Etat et du Conseil Départemental. Pour l’an 2 du CPV, il faut espérer un contexte de travail renforcé et l’approfondissement d’une méthode efficace d’animation territoriale des politiques publiques. Enfin, j’ai personnellement alerté le ministre de la ville, sur le budget dédié à la politique de la ville dans les Bouches-du-Rhône (14,2 millions pour le 13) et la dotation en matière d’adultes-relais, très en deçà des besoins nécessaires pour répondre aux enjeux stratégiques de notre territoire.