Penser la corruption
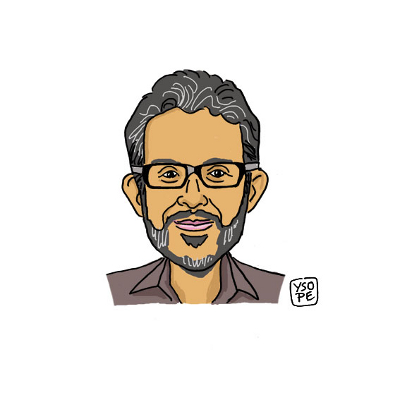
La corruption est un phénomène encore assez largement impensé dans nos sociétés démocratiques dites « avancées ». Le débat public oscille en effet entre deux représentations tenant lieu d’analyse. La première consiste en un déni social et politique renvoyant le problème vers des déviances individuelles isolées. C’est la métaphore du mouton noir dans un troupeau blanc et sain. Le système n’est pas en cause, les institutions fonctionnent bien, seuls quelques individus fautent car ils sont foncièrement malhonnêtes et, lorsque le fait est révélé (généralement par la presse), cela occasionne un « scandale », que le suivant chassera. La seconde représentation est, au contraire, une mise en accusation globale et indifférenciée de tout un groupe social. C’est la maxime populiste du « tous pourris ». Les individus disparaissent, c’est le groupe entier qui est jugé malhonnête. Ces deux représentations simplistes doivent être tenues à distance.
Depuis le travail pionnier du sociologue américain Edwin Sutherland, les sciences sociales ont dégagé des problématiques générales pour penser la corruption. J’en retiendrai ici cinq.
1) L’analyse des logiques d’affiliation et de clientélisme qui contribuent aux relations ordinaires entre d’une part la population générale et les élus locaux, d’autre part les décideurs publics (élus mais aussi fonctionnaires en général) et les entreprises du secteur marchand. La corruption suppose un jeu d’intérêts mutuels, des corrompus mais aussi des corrupteurs.
2) L’analyse des logiques individuelles et collectives du pouvoir, dans toutes ses dimensions. Logiques individuelles comme l’analyse des motivations dans la recherche du pouvoir, des rôles psychosociaux dans l’exercice du pouvoir et sans doute même des éventuelles addictions que cela peut provoquer. Mais aussi logiques sociales comme la pression exercée tant par les adversaires que par les associés dans la compétition pour le pouvoir.
3) L’analyse des comportements de corruption comme tout comportement délinquant : la façon dont ils sont appris au contact d’autres corrupteurs et corrompus déjà aguerris, dans leurs techniques de réalisation et de dissimulation, leurs discours et leurs justifications, etc.
4) L’analyse des représentations sociales générales qui, selon les secteurs, les professions, les régions et les pays tolèrent et justifient plus ou moins la corruption dans la vie sociale quotidienne.
5) L’analyse des systèmes de surveillance, des systèmes d’alerte (modes de dénonciation, rôle des médias, rôle des associations militantes), des systèmes de prévention et enfin des politiques nationales et internationales de répression policière et judiciaire, qui régulent plus ou moins les pratiques de corruption, pour ne pas dire qu’elles contribuent à assurer la plus ou moins grande impunité dont bénéficient de façon générale les corrupteurs et les corrompus du fait de la position sociale dominante qu’ils occupent et de la maîtrise incomparablement plus forte qu’ils ont du droit et des systèmes légaux de contraintes régissant la vie sociale.










