"Un autre abattoir est possible"
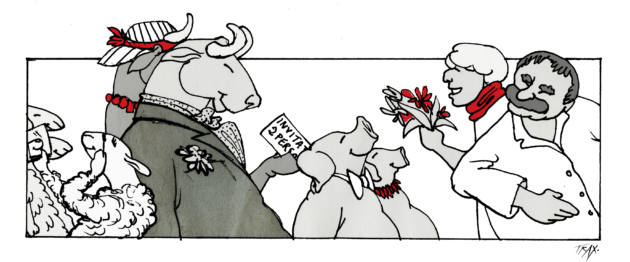
Il faut d’abord s’équiper : bottes blanches, charlotte et blouse en plastique. Dans le sas, qui mène à la salle d’abattage, quelques gouttes de sang par terre. Et surtout une odeur, forte et acre, probablement celle du sang, à laquelle on s’habitue finalement rapidement. Au loin se fait entendre le bourdonnement d’outils de découpe, comme une tronçonneuse. Le petit abattoir des hautes vallées est installé au pied des montagnes enneigées du Queyras, à Guillestre (05). Comme tous les mardis, à 8 heures du matin, c’est branle-bas de combat.
Organisé en SCIC (Société coopérative d’intérêt collectif), cet « abattoir de proximité » ne fonctionne qu’un jour par semaine et sans aucun salarié. La SCIC compte 141 sociétaires : consommateurs, Amaps, quatre communautés de communes réunies en syndicat mixte chargé d’entretenir le bâtiment et 84 éleveurs. « C’est la particularité de cet abattoir », souligne rapidement Bénédicte Peyrot, présidente bénévole de la SCIC, charlotte en plastique sur la tête : une dizaine d’éleveurs sont eux-mêmes tâcherons, chargés d’abattre et de travailler les carcasses d’agneaux, veaux, bœufs, cochons et même parfois chevaux. Imaginé sur le modèle d’autres petits abattoirs comme celui de Die dans la Drôme, ils ne sont pas payés, mais indemnisés.
Cet abattoir, construit il y a plus de 50 ans, était exploité en délégation de service public et comptait cinq salariés jusqu’à sa liquidation judiciaire à l’été 2016. « Il leur fallait toujours plus de volume, une course sans fin », assure la présidente. Le tout dans un contexte où la consommation de viande est clairement à la baisse et contestée (voir encadré) : mauvaise pour la planète, pour la santé, maltraitance animale, veganisme et activisme… La reprise en SCIC s’est faite six mois plus tard. Aidée d’un chargé de mission, Bénédicte Peyrot, qui « n’y connaissait rien » s’est formée en quatre mois. Tout comme les éleveurs, aidés par un tâcheron de l’abattoir de Die.
Du début jusqu’à la fin
« Ici c’est tout le contraire de l’élevage et de l’abattage industriel », insiste la présidente. Forte de caractère, elle concède qu’une « femme à la tête d’un abattoir ça ne plaît pas beaucoup » dans un milieu très masculin. « Plus on m’asticote, plus je suis dynamique, rigole-t-elle. Nous sommes aujourd’hui à l’équilibre. Nous avons produit 117 tonnes en 2019, dérisoire par rapport aux grosses machines qui courent après le profit. Notre objectif est de 150 tonnes, c’est réalisable. Toute la viande produite ici est issue d’élevages raisonnés ou bios et tous les éleveurs pratiquent la vente directe. Cela correspond à la volonté des consommateurs de manger moins de viande mais mieux, de savoir dans quelles conditions la bête est élevée et abattue. »
Deux autres femmes mettent la main à la pâte. L’une d’elles, Véronique Dubourg, prend un café avant d’attaquer la journée. « Moi, je suis un playmobil de l’agriculture. J’ai une cinquantaine de brebis et j’amène à l’abattoir une quarantaine d’agneaux par an », compte-t-elle. Joli bronzage, cheveux poivre et sel, elle n’est plus loin de la retraite. « Cela faisait trente ans ans que je me posais la question de la mort de mes animaux. Lors des premières réunions, je me demandais ce que je faisais là et je ne pensais pas passer la première matinée mais on s’y habitue vite. L’ambiance est très bonne, c’est important. » Benédicte Peyrot prend la suite : « Je dis toujours que l’abattoir c’est la vie ! Les éleveurs, qui sont parfois seuls, mangent ensemble, partagent des moments de convivialité. Et puis ils suivent leurs bêtes du début à la fin, se réapproprient leur mort et partagent des objectifs communs. » C’est aussi et surtout un outil structurant pour l’économie du territoire, qui évite aux éleveurs de parcourir des kilomètres pour se rendre à l’abattoir de Gap. Ce qui était le cas de François Humbert, éleveur moustachu de vaches allaitantes qui ressemble très étrangement au personnage du dessin ci-dessus.
On entre enfin dans la salle où tout se passe, où les bêtes passent de la vie à la mort, pour finir en chambre froide. Aujourd’hui, c’est une journée moyenne : 35 agneaux, cinq porcs, quatre gros bovins et un veau. Les bêtes sont étourdies puis saignées sur deux lignes différentes : les agneaux d’un côté, bovins et porcs de l’autre. Au début de la chaîne, un agneau montre le bout se son nez à travers un rideau de cuir noir. Il est étourdi à l’aide d’une pince électrifiée avant d’être rapidement saigné. Les tâcherons s’activent : on « habille » l’animal, en fait on le dépèce, on met de côté certains organes, on l’ouvre en deux, les entrailles à l’air, avant de le décapiter.
De l’autre côté, un énorme bœuf est suspendu à un croc de boucher. Sa tête fumante au sol et ses muscles saillants vibrent encore. Il attend d’être travaillé par un boucher professionnel. C’est calme, mis à part le boucan des machines. Un peu plus loin, un tâcheron utilise une énorme tronçonneuse pour couper de tout son haut un cochon de 100 kilos en deux, le groin dégoulinant de sang. Avant qu’il ne passe à la pesée puis soit conservé en chambre froide plusieurs jours pour ce qu’on appelle le « ressuyage ». Ensuite, les carcasses sont, pour la plupart, découpées sur place et mises sous vide.
Remise en question
La question de la souffrance animale, sur le devant de la scène depuis la publication de vidéos dénonçant la maltraitance animale dans les abattoirs par l’association L214, est bien sûr primordiale. Un vétérinaire, Lionel Gavet, est sur place. Son boulot est de s’assurer de la bonne hygiène de l’abattoir et des animaux abattus mais aussi de leur « bien-être ». « Beaucoup de progrès ont été faits depuis une vingtaine d’années. Et à titre personnel, je trouve que ce qui se fait ici est très intéressant, il n’y a pas de cadences, les animaux ne sont pas stressés : souvent les cochons roupillent dans la salle d’à côté ! »
Pour Brigitte Gothiere, l’une des fondatrices de L214, jointe au téléphone, « il n’y a aucune raison valable de tuer des animaux, sujets de leur propre vie, qui ont des rapports sociaux, des aspirations… », considérant que l’homme n’a pas besoin d’en manger. Mais elle consent à faire une distinction sur le plan du droit lorsque la loi sur le bien-être animal n’est pas appliquée : « Les limites de leurs souffrances est un vrai enjeu à défaut de leur faire la peau tout court. » Un débat philosophique sans fin.
Le secteur, face à sa dégringolade, se remet petit à petit en question. Les modèles coopératifs, où toute la chaîne est mise à contribution, se développent. C’est le cas de l’abattoir de Tarascon (13), qui a failli disparaître avant une refonte de son organisation. Dans le Luberon, un projet d’abattoir mobile est à l’étude. « En étudiant la faisabilité de l’outil, ce qui ressortait était l’impression d’abandon des animaux chez les éleveurs, de ne pas aller au bout avec eux. Avec en plus la volonté des consommateurs de savoir ce qu’ils consomment », explique Olivier Bel, porte-parole de la confédération paysanne en région. « Un autre abattoir est possible », répète à l’envi Bénédicte Peyrot.




