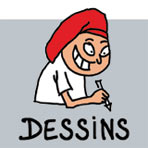Accueille-moi si tu peux !

« Marlboro, Marlboro, Marlboro » murmurent les « clandestins » à Noailles, quartier populaire au centre de Marseille, sur la place du marché des Capucins. Le sol mouillé, les étalages colorés, ici la poissonnerie, là-bas la superette, tout y est. Cela ressemblerait presque à un marché ordinaire, si les scènes de patrouille policière n’étaient pas aussi banales. Et pour cause, ici c’est le repère de beaucoup de réfugiés algériens et de migrants en situation irrégulière.
Ils ont une vingtaine d’années, casquette vissée sur la tête, ils traînent en bande et vendent du tabac à la sauvette. Nous les interpellons en arabe en nous inventant un cousin algérien qui voudrait bien lui aussi faire le grand voyage. « Dis-lui de ne pas venir, il n’y a rien à faire ici ! », s’énerve Samir. « Et toi ? Pourquoi tu es là alors ? Laisse-le faire sa vie », lui rétorque son collègue Amine. Le cercle autour de nous s’élargit, ils sont tous originaires d’Annaba, grande ville côtière de l’est de l’Algérie. Une chose est claire, ils ne fuient ni la famine, ni la guerre. « J’habitais à Saint-Cloud », confie Amine. Ce quartier est connu pour être celui des « riches », celui « des gens branchés », là où l’immobilier est hors de prix et où il est prestigieux d’y être vu. Certains l’appellent le quartier « choufouni » (« regardez-moi »), celui des m’as-tu-vu, des frimeurs. Mais ce jeune semble lui préférer Marseille et son lot de complications et d’inconfort.
Certains viennent en bateau avec des passeurs, ou en « flouka » (barques) de manière clandestine depuis la Sardaigne, en Italie. Ce voyage coûteux et dangereux a déjà valu leur vie à des milliers de « Harragas » (ceux qui fraudent). D’autres, entrent sur le territoire légalement avec des visas touristes et font le choix de rester. « Venir en valise », c’est l’expression qui leur est consacrée.
La plupart d’entre eux ont fait une demande d’asile. « Il faut y aller très tôt le matin, certains dorment sur place », indique Samir. Un autre jeune de la bande raconte son entretien : « Quand tu y es, il suffit de répondre à leurs questions, c’est eux qui font les dossiers, toi tu dois juste leur raconter un "qaleb" et trouver ce que tu peux dire sur l’Algérie. » En arabe un « qaleb » fait référence au « moule », il faut donc « mouler » son discours. Faire en sorte qu’il rentre dans la case. Ainsi, ils se transmettent des récits de vie comme des légendes urbaines.
La vérité si je mens
« L’Algérie reste comme l’année dernière le pays le plus représenté avec 1109 personnes (19,9 %) reçues pour la première fois et souhaitant déposer une demande d’asile à Marseille », explique Manon Tervel, chef de service de la Plateforme Asile qui a pour rôle d’accompagner des demandeurs d’asile, qui ne sont donc pas en situation irrégulière sur le territoire. Lorsqu’ils sont déboutés ou au contraire statutaires, ils sortent de leur suivi et ils sont orientés auprès d’autres structures. « Nous n’avons pas de données générales sur leur parcours et surtout pas sur le bien fondé de leur demande d’asile : c’est à l’Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides) et la CNDA (Cour nationale du droit d’asile) d’en décider », explique la responsable. Le taux de protection en 2016 pour les Algériens en France (Ofpra + CNDA) est de 9,8 % soit 209 décisions positives. Beaucoup de demandes mais peu d’élus, un écart qui s’expliquerait par les « récits de vie » que chaque demandeur d’asile doit fournir et qui doivent faire état de menaces réelles qui les ont poussés à quitter leur pays d’origine.
Comme le racontent les jeunes de Noailles : « Tu dis que rien ne va dans ton pays, tu parles de tes problèmes familiaux ou avec la "dawla" (l’État) ». Ils confient que les récits sont les mêmes pour tous, leur discours est bien rodé à l’avance. La menace islamiste, une sexualité consommée avant mariage, un passage à tabac sur un lieu de travail et la peur de représailles ou encore une homosexualité supposée font partie des scenari les plus courants.
Et cela n’aura sûrement pas échappé aux services compétents. « L’écart s’explique du fait de récits de vie qui ne relèvent pas tous des critères établis par la Convention de Genève relative aux droits des réfugiés, confirme Manon Tervel. Il est nécessaire d’avoir subi ou de craindre de subir des persécutions dans son pays d’origine mais également de démontrer que les autorités du pays ne peuvent ou ne veulent pas assurer la sécurité de cette personne. »
La France un refuge moral
La Convention de Genève qui régit le statut des réfugiés prévoit des conditions strictes quant à l’attribution de l’asile. Il faut bien correspondre à la case, à défaut, l’asile est refusé. Si la guerre n’est pas du fait des armes en Algérie, la pression est psychologique. « La société algérienne suffoque sous la pression de la famille et les traditions. La moyenne d’âge du mariage a baissé ces dernières années à 18 – 20 ans. S’ajoute à cela le fossé qui se creuse entre les classes sociales », note Kamel Chachoua, chercheur au CNRS, anthropologue et sociologue, spécialiste de la question de l’émigration algérienne. Et de poursuivre : « Il faut savoir aussi, qu’aujourd’hui, l’État n’est plus en mesure d’acheter la paix sociale, comme l’avait fait le président Bouteflika les précédentes années. » En effet, l’État avait lancé, au profit des porteurs de projet, le plan ANSEJ (l’Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes), organisme algérien chargé de la gestion d’un fonds de crédit pour la création d’entreprises. Elle participe au service public de l’emploi. Mais aujourd’hui beaucoup d’emprunteurs ne peuvent plus rembourser leur crédit.
« La France est un refuge moral pour les Algériens, poursuit Kamel Chachoua. Elle fait partie de leur passé du fait de la colonisation, mais elle fait aussi partie de leur avenir. Les personnes qui le peuvent, scolarisent leurs enfants dans des écoles françaises pour faciliter leur départ après l’obtention du bac. » Le canal migratoire le plus important en partance d’Algérie vers la France est celui des étudiants : près de 23 000 Algériens poursuivraient leur scolarité en France, soit 7 % des étudiants internationaux. L’Algérie représente la 3ème communauté d’étudiants en France. « Pour les Algériens, la France, c’est "l’autre" qu’on connaît très bien. Ils connaissent la culture, la langue, et pour eux, c’est un symbole de prestige », explique Kamel Chachoua.
Pour le sociologue, le choix de ces jeunes qui quittent leur famille et acceptent des conditions de vie très précaires en France – certains quittent un confort réel en Algérie – est une façon de se rebeller et de « dire à l’État et à la société qu’ils ne sont pas d’accord, qu’ils préfèrent claquer la porte pour un ailleurs meilleur ». Et Kamel Chachoua de conclure : « malgré tout, ils partent tous dans l’optique de revenir. »
Djamila Ainennas
Des visas lucratifs
À ce jour, l’Algérie est toujours le deuxième pays à obtenir le plus de visas de la part de la France : 200 000 ont été délivrés en 2012, 410 000 en 2016 et en août 2017 417 000 demandes avaient déjà été déposées (1). Les recettes tirées par l’État français de cette activité, au titre des droits de chancellerie, se sont élevées à près de 187 millions d’euros en 2015.
Pour traiter les demandes de visa de plus en plus importantes, l’ambassade de France externalise leur gestion à des entreprises privées. L’une d’elle – TLS contact – a été éclaboussée en 2016 par des scandales de fraude et de « détournement » des rendez-vous de dépôt de dossier. Le ministère des Affaires étrangères a donc décidé d’écarter l’entreprise. Mais si à ce jour TLS Contact a perdu Alger, elle continue ses services à Oran et Annaba jusqu’à décembre 2018, contrat oblige.
Le nouveau prestataire est VFS Global, derrière lequel on trouve Mawared House Algeria, une SARL dont l’actionnaire principal est le milliardaire influent Réda Benyounès. Qui n’est autre que le neveu d’Amara Benyounès, l’ancien ministre du Commerce et l’un des principaux animateurs de la campagne du 4ème mandat d’Abdelaziz Bouteflika en 2014 !
D. A.
Enquête publiée dans le Ravi n°160, daté mars 2018