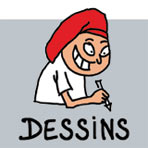Interruption volontaire du droit des femmes

Vous pouvez lire gratuitement cette archive du Ravi. Mais l’avenir du mensuel régional pas pareil, qui existe car ses lecteurs financent son indépendance, est toujours entre vos mains. Abonnez-vous, abonnez vos amis, vos ennemis, faites un don…
« Tant que les femmes ne descendront pas dans la rue et ne prendront pas le problème à bras le corps, rien ne se passera », explique le professeur Chafik Chraibi, gynécoloque au CHU de Rabat depuis 1984 et président fondateur de l’Association marocaine de lutte contre l’avortement clandestin (Amlac). Au Maroc, comme dans la majorité des pays du Maghreb, l’avortement est illégal (sauf mise en grand danger de la vie de la mère) et puni de peines d’emprisonnement de 1 à 5 ans pour l’avorteur et de 6 mois à 2 ans pour toute femme s’avortant elle-même. Pourtant, entre 600 et 800 femmes y auraient recours illégalement chaque année, dont environ 80 perdraient la vie.
En 2014, suite à un reportage d’Envoyé Spécial qui avait fait grand bruit dans le Royaume, Chafik Chraibi a été démis de ses fonctions de chef de service, Mohamed VI clamant qu’il s’était saisi du dossier. « Deux ans après son adoption en Conseil de gouvernement, on ne voit toujours rien venir, le dossier est enterré », ne décolère pas le gynécologue. Le projet de loi devait élargir le droit à l’avortement au cas de viol, d’inceste, de handicap mental et de malformation du fœtus. « Les femmes me téléphonent pensant que je peux les aider. Moi sûrement plus que les autres, je suis surveillé. Je n’ai droit à aucun faux pas », explique le médecin qui constate que, depuis 2016, les arrestations de médecins sont de plus en plus nombreuses.
Religieux et traditions
Coca-Cola bouilli, antipaludéens provoquant des fausses couches, produits en tout genre achetés sur le net, verre pilé, ou encore le sempiternel cintre, en Égypte les femmes s’avortent dans la solitude de leur chambre à coucher, souvent au péril de leur vie. Comme beaucoup de sujets qui touchent aux droits humains, l’avortement est tabou. En 2010, un projet de loi voulait l’ouvrir seulement aux femmes pauvres afin de limiter le nombre de naissances. Aujourd’hui, une femme sur huit qui se présente aux urgences obstétricales vient pour une complication suite à un avortement clandestin. Quand elles n’y parviennent pas, il reste l’abandon et les enfants des rues sont nombreux en Égypte…
Sans surprise, Fatah Al-Sissi vient d’être réélu et les choses ne sont pas prêtes de s’améliorer. La seule note d’espoir vient du petit écran, la série télé « Le 7e voisin » fait un carton auprès des Égyptiens. Réalisée par trois femmes, cette fiction donne la part belle à d’autres femmes vivant dans un immeuble du Caire. On y parle de l’avortement et du sexe hors mariage, une vraie révolution en Égypte. Les conservateurs crient au scandale, mais son immense succès lui permet de rester pour l’instant au programme.
Plus de 50 000 femmes meurent chaque année dans le monde des suites d’un avortement illégal. Dans beaucoup de pays de la Méditerranée, dont certains font partie de l’Europe, le droit des femmes à disposer de leur corps est sous contrôle de la religion… Algérie, Liban, Malte, ou encore Monaco. Seule note d’espoir, le parlement chypriote vient de voter une loi dépénalisant le recours à l’IVG, sans condition.
Le cas d’Israël est plein de contradictions. L’avortement est autorisé sous conditions (moins de 17 ans, plus de 40 ans, hors mariage, viol, inceste, risques pour l’enfant à naître ou la santé de la mère). « La requérante passe devant une commission composée de trois personnes dont au moins une femme, deux médecins et un travailleur social, nous explique Nedval Heyal de l’association féministe Icha L’Icha basée à Haïfa qui précise qu’« en pratique, peu d’avortements sont refusés ».
Mais l’association dénote une certaine hypocrisie du gouvernement et regrette l’absence de débat public sur la question. « En Israël, c’est un non-sujet », poursuit la militante. L’an dernier, deux députés du Likoud et de la Ligue arabe unifiée ont interpellé la Knesset pour l’ouverture de la commission à un représentant de la religion de la femme concernée. 20 000 Israéliennes ont recours chaque année à l’avortement de façon légale ou illégale. Du côté palestinien, l’IVG est considérée comme un crime. Certaines parviennent à se faire avorter du côté israélien à condition d’en payer le prix.
Le droit à l’avortement légal et sans condition n’est malheureusement pas une garantie définitive… La Tunisie fait figure d’exception dans le monde arabo-musulman, puisqu’elle a légalisé l’avortement en 1973, deux ans avant la France. Celles qui vivent en campagne ou sans le sou, ont pourtant du mal à y avoir accès. En Turquie, où il est légal depuis 1983, il est pourtant absent des hôpitaux publics. En 2016, un député de l’AKP avait déclaré « qu’un violeur est plus innocent que la victime d’un viol qui se fait avorter ». Erdogan le considère comme « un massacre » et connaissant sa faculté à restreindre rapidement les droits humains, on devrait bientôt en parler au passé.
En 2013, les Espagnoles se sont fortement mobilisées pour défendre un droit acquis seulement en 2010, face au gouvernement conservateur de Mariano Rajoy. En Italie, si le droit à l’avortement est inscrit dans la loi depuis 1978, en pratique, 80 % des gynécologues se réfèrent à « la clause de conscience » et refusent de le pratiquer (contre 10 % en Europe). Les ONG comptabilisent 50 000 avortements illégaux par an dans un pays où l’IVG est pourtant légale…
Disparités en Paca
En France, depuis 1975 et la loi Veil, le droit à l’avortement a connu des avancées : suppression du délai de réflexion obligatoire, prise en charge intégrale par la sécurité sociale, possibilité pour une mineure d’avorter sans l’accord de ses parents, délit d’entrave à l’IVG… Un arsenal que bien des pays Méditerranéens pourraient nous envier mais qui reste fragile, notamment lorsque le FN s’en mêle. De « l’IVG de confort » de Marine Le Pen pendant la campagne de 2012 à la proposition de déremboursement par Marion Maréchal (nous voilà)- Le Pen en 2016. En Paca, les femmes se retrouvent parfois face à des médecins indélicats et rencontrent encore des difficultés pour avoir accès à l’IVG.
Marion Mornet, coordinatrice du dispositif téléphonique du numéro vert au Planning familial 13 constate une disparité territoriale [0800 081111 (gratuit et confidentiel) / www.parlons-ici.org] . Dans le Var, très peu de médecins pratiquent l’IVG et dans les services, les délais d’attente sont très longs. « Dans le 04, aucun praticien n’accepte de faire une IVG au-delà de 12 semaines d’aménorrhée. Et dans le 05, c’est possible uniquement à l’hôpital de Gap. Pour avorter, une femme doit alors faire parfois deux heures de route », note Marion Mornet. Dans le 06, les dépassements d’honoraires que demandent les médecins posent problème car ils sont strictement interdits sur les actes d’IVG. Dans le 13 et le 84, le choix de la méthode n’est pas toujours possible.
« C’est toujours plus compliqué pour les personnes les plus vulnérables explique la référente du Planning familial. Certains services laissent beaucoup moins de choix à une femme mineure sur l’anesthésie ou la méthode, et insistent sur l’accompagnement en faisant une lecture de la loi qui est fausse. » Les femmes migrantes ne sont pas en reste. « L’IVG est considérée comme un soin urgent, on ne peut pas le refuser à une personne. Même si elle n’a pas de droits ouvrables à la sécurité sociale, elle doit être prise en charge », souligne Marion Mornet. Elle constate que la plupart des services IVG de la région refusent cet accès ou demandent des garanties de paiement, comme des chèques de caution. « Ce qui est totalement illégal ! Il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ils ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant ! » Simone de Beauvoir avait vu juste…
Samantha Rouchard
Des femmes à la mer
Le bateau de Women on Waves doit accoster au Mexique où l’avortement n’est légal que dans la capitale et illégal dans le reste du pays. Cette ONG néerlandaise, créée en 1999 par la médecin Rebecca Gomperts, propose des IVG médicamenteuses jusqu’à 10 semaines de grossesse, dans les eaux internationales où la loi des pays concernés ne s’applique pas et où celle des bateaux affrétés prend le dessus. Sur les six missions menées à ce jour, notamment en Espagne (2008) et au Maroc (2012), seules deux ont pu déboucher sur des avortements. Les autorités locales faisant en sorte de bloquer l’entrée du bateau dans les ports, quitte à sortir les navires de guerre, comme au Portugal en 2010. Mais pour l’ONG, l’important est avant tout de braquer les regards sur le manquement des pays aux droits humains, dans l’espoir de faire changer les lois.
S. R.
Enquête publiée dans le Ravi n°161, daté avril 2018