« Je ne casse pas, j’essaie de réparer »
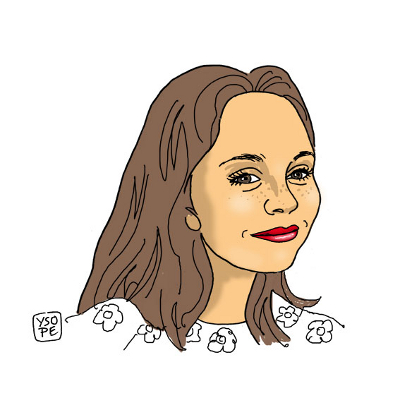
Je n’étais jamais descendue dans les rues. Je croyais fort en la démocratie et en mon pays. Après tout, la France est celui des « Droits de l’Homme ». Quelle naïveté…
Le 17 février une ébauche du projet de loi « El Khomri » est diffusée dans la presse. La révolution est en marche. Une première manifestation a lieu à Marseille le 17 mars. Le mouvement est pacifique jusqu’à l’arrivée de trois voitures de police dans le cortège. La manifestation dégénère : les policiers interpellent alors un jeune lycéen de 16 ans. Le jeune homme ressortira traumatisé par sa garde à vue. Il a reçu plusieurs coups. Il a de nombreux hématomes ainsi qu’un traumatisme crânien.
Malgré l’hostilité, le gouvernement ne faiblit pas. Les manifestations sont de plus en plus violentes et répétées jusqu’à ce fameux 28 avril. La grève est totale. Syndiqués ou non, travailleurs ou étudiants, c’est ensemble que nous faisons face aux CRS et à la Bac dont les effectifs ont été renforcés en prévision du nombre croissant de militants. La colère gronde et les forces de l’ordre doivent la faire taire.
C’est à coups de flash-balls et de lacrymogènes qu’ils essaient de disperser la foule. La panique nous gagne. Comment lutter ? Malgré cela, les étudiants décident de continuer. Accompagnés par quelques militants Solidaire et Sud éducation, nous partons en « manif sauvage ». Les plus téméraires passent devant la banderole et renvoient les « lacrymos ». Poursuivis par la Bac, il ne reste plus qu’une chose à faire : bloquer les rails afin d’interrompre le trafic ferroviaire. Le blocus s’éternisera sur plus de 4 heures. Le symbole est fort, et le préjudice financier pour la SNCF n’est pas négligeable. Malheureusement ce genre d’action a un coût, la journée du 28 avril sera marquée par 54 arrestations souvent très violentes, ainsi que par de nombreux blessés.
Néanmoins nous ne lâchons rien. Le 31 mars nous voilà à nouveau dans les rues plus nombreux que jamais. Après délibération, nous décidons de continuer malgré la menace policière. Les lacrymogènes pleuvent, les équipes de secours sont débordées. La CGT et FO qui constituaient la majeure partie du cortège ont disparu, nous sommes seuls. Nous rebroussons finalement chemin. Arrivés à notre point de départ, la police nous attend. Une jeune fille essaie de passer le barrage, elle est violemment interpellée. On la plaque au sol, elle est rouée de coups, elle essaie de résister, en vain. Elle finit par s’évanouir avant d’être transportée dans une voiture de police. Comment rester impassible face à tant de violence ? Je veux l’aider mais on m’en empêche pour mon bien. Pourquoi cela doit se passer comme ça ?
Nous recevons des grenades, puis des lacrymogènes et enfin des flash-balls. Un garçon s’effondre en hurlant : il a reçu un éclat dans le genou. On se croirait en enfer. Soudain je ressens une douleur dans la main. Une trace rouge apparaît, je viens de recevoir une « flash ». J’étais à 6 mètres : à cette distance, on peut parler de tir à bout portant. Je m’en sors avec un hématome et une fracture du petit doigt.
Les manifestations et les violences perdurent. Des deux cotés, la fatigue se ressent. On est tous à cran, et les médias en rajoutent. Les reportages glorifiant la police font loi. On nous traite de « sales gauchistes », de « casseurs », de « petits cons ». Mais qu’en est-il des policiers qui enfreignent la loi en faisant usage de la force sans sommation ? J’ai décidé de rejoindre la « team médic ». Je ne casse pas, j’essaie de réparer. Je n’ai pas peur de la police : j’ai peur de mon avenir.




