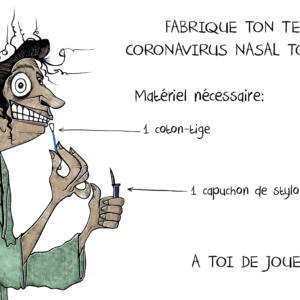La fraise au fusil

« Tchok, tchok, tchok ». Le bruit cadencé d’une fraise qui s’arrache de son pédoncule a quelque chose de presque satisfaisant. Beaucoup moins après une heure ou deux passé sous serre le dos plié en deux. Il est 8 heures du matin ce jeudi mi-avril, un ciel rose et violacé s’est levé il y a peu sur le Mont Ventoux. Sixième génération d’agriculteurs, Philippe Bon exploite depuis vingt-cinq ans quinze hectares de terres à Pernes-les-Fontaines dont quatre de « fraises de Carpentras », une marque déposée. Il est d’ailleurs vice-président du « syndicat de défense de la fraise de Carpentras » et vice-président de la FDSEA de Vaucluse (1).
La saison dure trois mois, jusqu’à mi-juin. Ici, la récolte a démarré le 16 mars, la veille du confinement… Il a réussi à se procurer au débotté des masques fabriqués localement, des visières en plastique à la pharmacie et du gel hydroalcoolique. Le coronavirus lui a d’abord fait perdre un tiers de ses débouchés, principalement vers la restauration. Il a dû stopper les quelques exportations habituelles en Suisse et, dans la grande distribution, affronter la concurrence espagnole : « Comment vous voulez lutter contre une fraise qui coûte deux euros cinquante le kilo à produire là-bas contre environ cinq ici ? Heureusement que nous sommes montés au créneau auprès du préfet. Pour l’instant la grande distribution joue le jeu et achète nos fraises au bon prix. Mais pour combien de temps ? »
Concurrence espagnole…
En ce moment, il emploie une trentaine de personnes, jusqu’à 48 heures par semaine, six jours sur sept, payées au SMIC, heures sup’ majorées : « Ils gagnent 2 000 euros par mois et plus », assure le patron. Une douzaine de saisonniers espagnols sont là, des habitués qui viennent travailler six mois en France pour un bien meilleur salaire qu’au pays. Philippe Bon assure n’avoir jamais eu recours aux travailleurs détachés, dont les intermédiaires espagnols ont fait scandale dernièrement (2). Une dizaine d’immigrés tunisiens, en contrat OMI (autorisés à travailler en France le temps de leur contrat), sont également présents. « Six autres devaient nous rejoindre mais ils sont restés bloqués, explique Phlippe Bon. On a dû recruter en urgence localement. » En Seine-et-Marne, le préfet se félicitait fin mars de «mobiliser» les réfugiés face à la pénurie de main-d’oeuvre du secteur agricole…
« La terre est basse »
Ramasser des fraises n’est dans le principe pas compliqué. Prendre une cagette, appelée « plateau », la remplir de barquettes et cueillir en se baissant plus bas que terre. Deux techniques (sans qu’aucune d’elles ne fonctionnent réellement) : soit se péter le dos, soit jouer sur les jambes. Les plus belles fraises sont d’un rouge pétant, comme lustrées. Pas besoin de sucre pour l’enfourner dans le gosier. Philippe Bon assure n’avoir utilisé qu’une fois des pesticides cette année sur ces cultures… Une fois les plateaux remplis, on les pose sur des palettes que surveillent des chefs d’équipe. La matinée, les Espagnols blaguent entre eux et avancent beaucoup plus vite que le Ravi sous une serre où la température est encore agréable : le plastique a été peint en blanc pour éviter que le soleil ne tape trop fort. Le masque ou la visière ne sont pas très pratiques mais les rangs sont assez espacés pour respecter grossièrement les distance de sécurité. Aujourd’hui, environ 2,5 tonnes de fraises seront ramassées, 120 en une saison.
… et dépendance étrangère
Dans la serre voisine, quatre « Français » s’affairent dont Corinne Angelras et Laurence Bellon qui habitent Carpentras. Toutes deux vendeuses dans un magasin de prêt-à-porter, elles sont au chômage partiel. Elles ont tenté de faire une journée complète mais le boulot est trop physique. Elles ne travailleront que le matin : « Disons que la terre est basse, rigole Laurence, 50 ans. Et on a eu 34 degrés l’après-midi dans les serres… » « Chapeau aux autres qui font jusqu’à 48 heures par semaine… Nous on le fait pour dépanner mais c’est pénible », admet Corinne, 46 ans, pour qui le travail des champs est une première. Cette dépendance à la main d’œuvre étrangère et qualifiée est vue comme une fatalité par Philippe Bon : « On n’a pas le choix ! On a du mal à trouver des travailleurs français. Les pays dits développés ont remplacé l’homme par la machine, on a plus l’habitude de se baisser… Mieux rémunérer ? Pourquoi pas, à condition qu’on achète nos produits plus chers alors…. »
À 13h, le travail reprend. Six Tunisiens, jeunes et moins jeunes, occupent une serre. On plaisante facilement. Parmi eux, deux femmes d’origine tunisienne mais qui habitent tout près d’ici. Elles ont trouvé ce job par Pôle Emploi. Pour Naila, d’habitude femme de ménage en intérim à Avignon, « même si c’est dur, c’est plus d’argent. ». Rabia, elle, vend d’habitude des vêtements sur les marchés. « Bientôt, c’est Ramadan, cela na va pas être simple… Mais ici on se déconfine ! Le virus, il est déjà partout sur Facebook, à la télé… Au moins on pense à autre chose. » Le travail, c’est la santé…
1. Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles, affiliée à la FNSEA.
2. Spécialisées dans l’interim agricole les sociétés Terra fecundis et Laboral Terra (voir nos numéros 138, 140, 167 et 179) sont poursuivies par la justice. Pointées du doigt pour leurs conditions de travail, la première doit comparaître en mai à Marseille pour fraude sociale mais l’audience pourrait être reportée.