« Je veux faire des films culte »
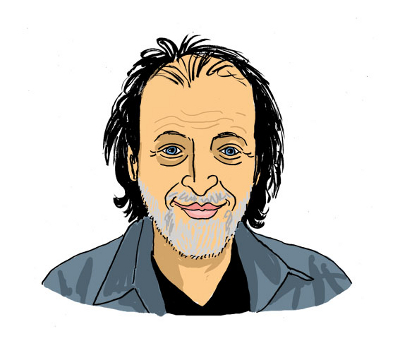
Le dessin de presse cela fait sens pour vous ? Même si je n’ai jamais ri aux éclats devant un dessin de presse, les dessins me donnent envie de lire les articles. C’est important pour moi cette dimension ludique : ne pas se prendre au sérieux et dire des choses graves, soulever des problèmes, dénoncer, sans être récupéré par les uns ou les autres.
Pourquoi avoir soutenu notre journal en réalisant cette « PPP », cette « pub pas pareille » ? (Cliquez ici pour la visionner) On est confronté aux mêmes problèmes et on se doit de se soutenir les uns les autres, de créer du réseau, de s’associer… Ce n’est pas un hasard si je prépare actuellement un film sur le Massilia Sound System. Cette quête de sens est fondamentale pour moi. C’est aussi pour cette raison que j’ai réalisé ce clip pour le Ravi (1) [Cliquez ici pour le visionner]. Je ne suis pas publiciste. J’ai fait ce court format comme je fais mes films : à l’instinct, sans chercher à intellectualiser, sans faire d’études de marché…
Qui est Jean-Marc, qui « entre en fusion » pour le Ravi, l’inoubliable patron de bar des Quatre saisons d’Espigoule, qui joue dans tous vos films ? Est-ce votre alter-ego ? (Cliquez ici pour voir Jean-Marc…) Oui, on forme un peu un tandem. Jean-Marc n’est pas un acteur professionnel, mais un acteur né. Il a plus que du talent. C’est peut-être de famille ou le résultat de ses 22 ans de comptoir au bar, quand il tenait le bar. C’est un vrai génie. Il a une vitesse de réflexion incroyable. Il est aussi le véhicule d’une identité extrêmement ancrée chez les Provençaux depuis plusieurs générations. Quand je l’écoute parfois, je me dis qu’ils devaient avoir le même humour au XVIIIe siècle ! On est du même village, on a même des liens de parenté. J’ai commencé très tôt à le suivre et à faire des films avec lui, il est devenu mon personnage central.
Pourquoi l’improvisation a autant d’importance dans votre travail ? Je demande à mes acteurs de ne pas lire ni d’apprendre les dialogues. L’important, c’est que je sache où je veux en venir et ce que je veux leur faire dire. La manière de le dire leur appartient. C’est rare que je tourne dix fois la même scène parce que ma quête d’authenticité ne me permet pas d’épuiser les acteurs. Je reproche aux films français d’être trop écrits, trop littéraires. Je veux essayer de faire sortir de la bouche de mes acteurs des choses que je serais incapable d’écrire. Et souvent, ça marche dans le feu de l’action.
Vous jouez souvent avec la frontière documentaire/fiction. Qu’est-ce que cette ambiguïté apporte à vos films ? J’ai souvent réalisé les fictions en utilisant les codes du documentaires et inversement. J’aime bien le mélange des genres. Il y a tant à inventer dans ce domaine. Cela impose une grande authenticité de la part des acteurs. On n’imagine pas un documentaire où les personnages sonnent faux, alors que dans une fiction cela ne nous étonne plus. Les gens au cinéma ne parlent pas comme dans la vie. Je pousse mes acteurs à vivre les choses, pas à les jouer. Je n’aime pas qu’on dise qu’un acteur joue bien. J’aime jouer avec l’ambiguïté aussi, comme dans Les quatre saisons d’Espigoule, afin que le spectateur se demande : « Ces personnes jouent-elles ou sont-elles filmées sur le vif ? » Ça fascine certains, ça dérange d’autres… C’est également une voie dans laquelle je me suis engagé pour des raisons économiques : le cinéma du réel coûte beaucoup moins cher et me permet en quelque sorte d’assouvir mon désir de fiction. Au point de ne plus savoir moi-même comment classer mes films. Avec Afrik’aïoli, il me semble avoir atteint une totale ambiguïté. Le film ne respecte ni les codes du documentaire, ni ceux de la fiction. Et pourtant il réussit à toucher un large public. Je trouve ça vraiment passionnant.
Vos budgets sont réduits pour réaliser ces films. Finalement, est-ce un atout ? L’atout le plus important, c’est la liberté. Plus on a de moyens, plus on a de contraintes et plus on se retrouve dans des schémas figés, formatés. Quand on fait Afrik’aïoli avec un budget de court-métrage, la liberté est absolue. Le tournage en Afrique a duré 2 semaines : on a beaucoup tourné sans prendre une seule journée de repos, et avec de tout petits salaires. C’était le seul moyen de faire exister ce film, et il n’y a plus de durée de travail syndicale… (Rires). Faire 100 000 spectateurs avec Les quatre saisons d’Espigoule, le film le plus fauché de l’année, c’est pas mal. Il n’a pas rapporté d’argent, mais cette année-là, on était premier ex-æquo avec Astérix et Obélix en termes de rendement (rapport du nombre d’entrées et du coût du film) ! Idem pour Afrik’aïoli, 17e en termes de rendement. Je ne cherche pas à faire des millions d’entrées, mais des objets cinématographiques « cultes », des films avec lesquels on vit, qu’on a besoin de revoir et qui nous construisent. Mes films pourraient être tout à fait rentables si les grandes chaînes nationales les diffusaient. Mais globalement elles continuent à les boycotter car je ne travaille pas avec des acteurs connus, que je suis dans une ambiguïté entre fiction et documentaire alors que le cinéma à la télé tend à se formater de plus en plus, et que je fais des films avec une charge identitaire forte. Le régionalisme est mal vu dans notre pays jacobin, même quand il rime avec universalisme !
Que représente la Provence pour vous ? Je suis né et j’ai grandi ici, j’ai décidé d’y rester. Quoi de plus normal ? On m’a toujours dit que pour faire du cinéma, il fallait monter à Paris. J’ai entendu ça 25 fois par jour lorsque j’étais plus jeune et j’ai fini par rejeter cette idée. Oui, on peut dire que je suis amoureux de cette région, mais c’est tellement naturel pour moi de faire du cinéma ici… Si j’écris des dialogues pour un Parisien, je suis obligé de me faire corriger, je suis tellement habitué à faire parler les gens du sud…
Quel est votre regard sur cette Provence crispée sur une identité disparue fantasmée, inquiète de se faire « envahir » ? La majorité des Provençaux ne sont pas fachos. Même au sein des électeurs du FN, il ne faut pas faire de généralités. Mais c’est vrai qu’il y a cette vision de l’identité qui est totalement différente selon qu’on se place du point de vue des occitanistes ou de celui des identitaires qui sont un peu paranoïaques. Une identité peut être ouverte aux autres. Dans Travail d’arabe, il y a une scène où Jacques Bastide et Momo se disputent sur cette question-là. Pour Jacques, il faut 25 générations de Provençaux pour être Provençal. Momo, lui, est né ici : il joue aux boules et mange du saucisson. Dans le texte, on l’avait qualifié de « Provençal d’origine maghrébine ». Il suffit de naître ici, d’aimer cette région pour être Provençal. J’assume ces questions d’identité, de régionalisme, même si ça choque certains. Il ne faut pas les laisser à l’extrême droite. Mais je comprends aussi cette tension, cette peur de perdre quelque chose : c’est le sens de l’histoire, dans 50 ans, s’il y a encore une Provence et que ce n’est pas un désert, sans doute qu’on sera un peu plus bronzé qu’aujourd’hui. Et pas seulement en raison des UV ! Et alors ?
Propos recueillis par Michel Gairaud et Nicolas Richen
(1) Avec la complicité active de Patrick Barra, l’associé de Christian Philibert dans la société de production Les films d’Espigoule. Qu’il en soit remercié !

