En Etat d’urgence !
 Jean-François Krzyzaniak, ancien de la rue
Jean-François Krzyzaniak, ancien de la rue
« La rue devient une addiction, comme l’alcool »
« J’ai mis sept ans pour sortir de la rue. Les échecs et les tentatives se renouvèlent. Le droit à l’échec et au recommencement est très important. La rue, au-delà d’un certain nombre d’années devient une addiction, au même titre que l’alcool. Un travailleur de rue qui faisait des maraudes et une infirmière, m’ont permis de sortir de la rue. 80 % des SDF ont des troubles psychiques car la rue abîme. Sans parler des addictions. Dans la rue on constitue une meute avec quelques copains. Ce n’est pas une famille, il y a un chef, l’alcool. Il est plus facile d’y boire du vin que de se faire chauffer un café ou du thé pour accepter cette nouvelle journée qui arrive. Tout est difficile. Le jour où l’on a rendez-vous avec un médecin, si on n’a pas pu prendre une douche avant, s’il nous reste encore un peu de dignité, on n’ose pas y aller. Et puis on a peur du diagnostic. Et puis on a parfois deux grammes. Parfois, les travailleurs sociaux ne comprenaient pas mon refus d’aller à l’hôpital sans mon chien. Ils ne comprenaient pas que mon chien pouvait me permettre de me soigner. Et puis désormais, à l’hôpital, ils sont là pour faire du chiffre sous la contrainte financière. C’est grave. D’autant plus que les gens qui risquent le plus de tomber dans la grande précarité, ce sont les personnes seules, que ce soit en ville ou en milieu rural.»
 Vincent Commaille, moniteur-éducateur stagiaire à Marseille
Vincent Commaille, moniteur-éducateur stagiaire à Marseille
« Être logé, c’est primordial pour la santé ! »
« Pour la santé, avoir un toit au-dessus de la tête, c’est primordial. Voilà pourquoi, après avoir connu ce dispositif en Australie, quand j’ai su qu’était expérimenté à Marseille le dispositif « un chez soi d’abord », j’ai voulu faire un stage à HAS (Habitat alternatif social). Pourquoi ? Parce qu’en France, avec les personnes sans-abris, on fait parfois les choses à l’envers. Quand elles ont des troubles psy, on essaye de les soigner avant de leur trouver un logement. Or, aux États-Unis, on s’est rendu compte qu’il était plus judicieux de d’abord leur trouver un logement avant de pouvoir les soigner. Pour le suivi des traitements, c’est plus efficace puisque chaque semaine, les gens hébergés se voient épauler par une équipe pluridisciplinaire qui est là pour les accompagner dans leurs démarches et être à l’écoute de leurs besoins. D’après les premiers résultats, cela aurait même permis à bon nombre de personnes, non seulement d’avoir un toit au dessus de la tête, mais de rentrer dans un processus d’insertion, avec parfois un travail. Il est clair que cela ne peut convenir à tout le monde, certaines personnes ayant besoin d’être au sein d’une collectivité, mais ce qui est sûr, c’est que c’est moins cher que le parcours classique. Une journée à l’hôpital, c’est 400 euros. Soit le loyer d’un mois pour un studio… »
 Elise Vallois, juriste au Comede
Elise Vallois, juriste au Comede
« La santé, c’est aussi une question de droit »
« Depuis 35 ans, le Comede – le comité médical pour les exilés – œuvre pour le droit à la santé des étrangers. Et, depuis bientôt cinq ans, il y a une antenne à Marseille avec une juriste et un médecin. Pourquoi une juriste ? Parce que la santé, c’est aussi une question de droit. Il y a en effet normalement pour les étrangers des droits concernant l’accès à la santé, au soin, à une couverture sociale. Mais, pour des raisons politiques, budgétaires, par racisme aussi, il est de plus en plus difficile de les faire respecter. Nous débloquons certaines situations, comme un refus de soin à l’hôpital… Car le souci, c’est que, du fait de ces blocages, les personnes ne sont pas soignées ou renoncent à l’être. Ce matin, j’ai encore été appelée par une personne dont la mère de 70 ans s’est fracturé le col du fémur mais que l’hôpital refuse de prendre en charge parce qu’elle n’est pas inscrite à la sécurité sociale ! Et je ne parle pas de ces échos insistants selon lesquels à l’hôpital Nord, si l’on ne vient pas avec quelqu’un parlant le français, on peut se faire refouler quand on demande un IVG… De fait, la question sanitaire est de plus en plus une question juridique parce que, malheureusement, elle n’est plus politique. Occupés sans cesse à résoudre des situations d’urgence, on n’a plus le temps de se mobiliser pour établir un rapport de forces… »
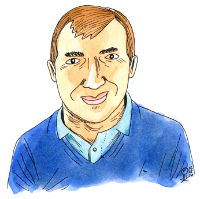 Bertrand Pavillon, responsable service social CHI
Bertrand Pavillon, responsable service social CHI
« Il faut faire du sur mesure avec les sans-domicile »
« Je suis responsable du service social du Centre Hospitalier intercommunal de Toulon – La Seyne sur Mer. Les personnes sans domicile fixe perdent vite quatre repères fondamentaux. Ils perdent le rapport à leur propre corps et ont tendance à minimiser leur pathologie. Ils perdent le rapport au temps car ils vivent dans une boucle perpétuelle : donner un rendez-vous à une personne en grande exclusion à une heure fixe, c’est illusoire. Ils perdent le rapport à l’espace. Ils perdent le rapport à l’autre. Sachant cela, comment créer un échange avec un médecin, un travailleur social ? Le travail est complexe. On ne peut pas faire du prêt à porter avec des personnes en grande exclusion. On est obligé de faire du sur-mesure : accompagner, rester par exemple auprès du patient jusqu’à ce qu’une ambulance arrive. Tous ces petits gestes, qui peuvent paraître rien, mais qui sont essentiels… Tous les SDF n’ont pas une pathologie psychiatrique, loin de là, mais tous ont de la souffrance psychologique. Les problématiques liées à l’alcool sont un fléau. Souvent on n’arrive pas à instaurer un dialogue. C’est souvent difficile de stabiliser une personne que l’on doit soigner dans un lieu. L’espérance de vie d’une personne à la rue est de 47 ans, celle d’une personne vivant dans un pays sous développé. Il est utile de former le personnel médical et soignant qui, aux Urgences à l’hôpital, reçoit souvent des gens en grande difficulté.»
 Anne Verola, infirmière au CHU de Nice
Anne Verola, infirmière au CHU de Nice
« La préfecture leur conseille d’aller ailleurs »
« A Nice, notre grosse chance [en matière d’urgence sociale] est d’avoir une seule Urgence, qui propose une évaluation globale (sociale et sanitaire), et un réseau d’associations qui se connaissent et travaillent ensemble. La principale difficulté est la proximité de la ville avec la frontière italienne. Nous avons beaucoup d’activités en lien avec des demandeurs d’asile, une population qui ne veut pas rester. Mais comme il n’y a plus aucune place d’accueil et pas d’argent, ces personnes sont nomades ou vivent chez des précaires. Le préfet leur conseille d’ailleurs d’aller faire leur demande [dans d’autres départements], dans des zones moins denses […] L’autre gros souci est le prix du foncier, pourtant nécessaire à l’augmentation des capacités d’hébergement de la ville. Car c’est uniquement quand les gens ont un hébergement d’urgence, que les demandes de soins peuvent suivre. »
 Enora Jumellin, future éducatrice spécialisée
Enora Jumellin, future éducatrice spécialisée
« Au moins, on n’a pas connu l’âge d’or… »
« Je suis actuellement en formation à Avignon, en deuxième année, pour devenir éducatrice spécialisée. Après mon bac, je ne savais pas quoi faire. A la Fac de mathématiques, c’est tous les jours que je me demandais ce que j’allais bien pouvoir devenir. J’ai à peine tenu un semestre. Le social m’attirait, mais c’est après avoir bossé avec des enfants autistes que j’ai su que je voulais devenir éducatrice spécialisée. Ma belle-mère étant elle-même « éduc spé », j’ai pu en discuter avec elle. De fait, on est déjà un peu désabusé parce qu’on sait, d’ores et déjà, qu’il faudra toujours faire plus avec toujours moins. Et je ne peux que partager le constat dressé lors des états généraux : faire plus avec moins, répondre à des appels à projet alors qu’on est censé partir de la demande des gens sur le terrain… Après, dans notre centre de formation, on n’essaye pas de nous vendre du rêve. Et puis, ce sera peut-être plus facile pour nous parce qu’on n’a pas connu l’âge d’or. On sait très bien qu’on ne pourra pas partir une semaine en Espagne avec un groupe de 10 personnes… On sait qu’on va devoir dès le début compenser le manque de moyens par nos envies et notre énergie. On a signé, c’est pour en c… »










